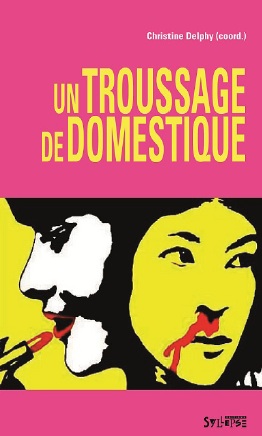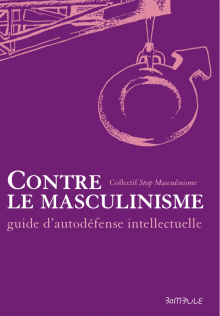Silvia Federici, Caliban et la Sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive. Traduction de l’anglais (États-Unis, 2004) par le collectif Senonevero, revue et complétée par Julien Guazzini. Coédition Senonevero, Marseille, Entremonde, Genève, 2014. 464 pages, 24 euros.
Ce livre s’est laissé désirer : il aura fallu dix ans pour qu’il paraisse enfin en français, alors qu’il avait déjà été traduit en diverses autres langues… Et même cette parution tardive a connu quelques contretemps : elle avait été annoncée pour 2013, semble-t-il. Mieux vaut tard que jamais – même si, au passage, il faut signaler aux éditeurs quelques (petits) problèmes de traduction et encore pas mal de coquilles. Bref, on ne fera pas la fine bouche, tant l’ouvrage est intéressant.
Caliban et la sorcière sont des personnages de Shakespeare (dans La Tempête) qui symbolisent, nous dit Federici, la résistance à la colonisation des Amérindiens. De fait, précise-t-elle, c’est surtout Caliban qui a incarné, dans le discours des résistants d’Amérique, les peuples aborigènes massacrés par les Blancs. Sa mère, la sorcière Sycorax, « est toujours invisible, comme l’a été de longue date la lutte des femmes contre la colonisation ». Pourtant, à l’instar de celles du vieux continent, les femmes indiennes furent très souvent à l’avant-garde des luttes contre les conquistadores, au point que ces derniers organisèrent de véritables chasses aux sorcières, au Mexique comme au Pérou, afin de briser ces résistances. Ainsi, « la figure de la sorcière, reléguée à l’arrière-plan dans La Tempête [est-elle] placée au centre de la scène dans le présent ouvrage : incarnation d’un monde de sujets féminins que le capitalisme devait détruire – l’hérétique, la guérisseuse, la femme insoumise, la femme qui osait vivre seule, la femme obi qui empoisonnait la nourriture du maître et incitait les esclaves à la révolte ». Que l’on ne s’y trompe pas : Federici ne donne pas pour autant dans le panneau d’un romantisme différentialiste à la Michelet (cf. La Sorcière, dans lequel l’« éternel féminin », pour être réinterprété dans un sens plus favorable aux femmes, n’en reste pas moins profondément essentialiste). Elle se réclame plutôt d’un courant de pensée marxiste, tout en se montrant critique vis-à-vis des insuffisances du marxisme traditionnel, en particulier de son analyse de l’accumulation primitive : « Là où Marx [l’]envisage du point de vue du prolétariat salarié masculin et du développement de la production des marchandises, je l’examine en fonction des changements qu’elle a induits dans la position sociale des femmes et la production de la force de travail. Ma description de l’accumulation primitive comprend ainsi un ensemble de phénomènes historiques absents chez Marx et qui ont pourtant été très importants pour l’accumulation capitaliste. Ce sont : (1) le développement d’une nouvelle division sexuée du travail assujettissant le travail des femmes et leur fonction reproductive à la reproduction de la force de travail ; (2) la construction d’un nouvel ordre patriarcal, fondé sur l’exclusion des femmes du travail salarié et leur soumission aux hommes ; (3) la mécanisation du corps prolétaire et sa transformation, dans le cas des femmes, en une machine de production de nouveaux travailleurs. » Caliban et la Sorcière documente ainsi en une magistrale étude historique les thèses d’autres théoriciennes marxistes du féminisme, comme, entre autres, Roswitha Scholtz, qui a critiqué et approfondi la « critique de la valeur », lui reprochant de trop souvent laisser « complètement de côté […] le rapport entre les sexes ». « Clairement, poursuit-elle, ce ne sont […] que la “valeur” et avec elle le “travail abstrait” – sexuellement neutres – qui sont dignes d’être théorisés, même si c’est en tant qu’objets d’une critique radicale. Ce qui demeure ignoré, c’est le fait que, dans le système de la production marchande, il faut aussi pourvoir aux tâches domestiques, élever des enfants et soigner les personnes faibles et malades, qu’il faut donc exécuter des tâches dont la charge incombe habituellement aux femmes […] » C’est ce que Scholtz nomme la « dissociation sexo-spécifique », que l’on ne doit pas prendre, explique-t-elle, pour une simple « dérivation », ou un « sous-système » du système de la valeur, mais qui constitue « une part essentielle et constitutive du rapport social global »[1]. En fait, la « valeur » n’existe pas sans la « dissociation » et réciproquement. Traduit dans les mots de Federici, cela signifie que sans le travail « mythifié » (escamoté, invisible) des femmes, pas d’accumulation possible, pas de capitalisme qui tienne.
Mais ce résultat ne fut obtenu qu’au prix d’une véritable guerre qui fut livrée, en Europe puis aux Amériques, en Afrique et dans le reste de monde, contre les structures villageoises et communautaires traditionnelles. Dissocier production (de marchandises) et reproduction (du travail et des travailleurs) n’allait pas de soi. Nous avons tous entendu parler des enclosures, ce processus qui consista à diviser en parcelles privées les « communaux » autrefois travaillés en commun. Pour stratégique qu’il fut, ce phénomène ne représentait que la pointe émergée de l’iceberg : car ce fut la vie humaine dans son ensemble, dans les villes comme dans les campagnes, dans les esprits comme dans les corps, qui fut bouleversée par la montée en puissance des rapports marchands. C’est, en gros, tout l’objet du livre de Federici, à ceci près qu’elle souligne aussi l’actualité continuée du processus d’accumulation primitive. Aujourd’hui, dit-elle, « les conquistadors sont les pontes de la Banque mondiale et du FMI, qui professent qu’“un sou est un sou” aux mêmes populations que les puissances dominantes ont dévalisées et paupérisées depuis des siècles. »
Caliban et la Sorcière est organisé en cinq parties que je vais essayer de résumer ici. Il s’agit bien sûr de ma lecture, qui sera forcément lacunaire – mais, je l’espère, pas trop déformante…
Il faut à tout ce monde un grand coup de fouet. Mouvements sociaux et crise politique dans l’Europe médiévale[2]
On a très souvent présenté le Moyen Âge comme une période de ténèbres, d’obscurité, par opposition aux « Lumières » du xviiie siècle. Ainsi, la chasse aux sorcières a-t-elle longtemps été tenue pour une barbarie moyenâgeuse. Or il n’en est rien, puisque les chasses les plus meurtrières se sont déroulées fin xve début xvie, soit précisément durant la période qu’il est convenu d’appeler « Renaissance », en même temps que la naissance de l’imprimerie, la « découverte » des Amériques et l’invention des philosophies « rationalistes ». En fait, la fin du Moyen Âge fut le théâtre d’une vague de luttes sociales intenses : « Comme le montrent les registres des tribunaux seigneuriaux en Angleterre, le village médiéval était le théâtre d’une guerre quotidienne. Elle atteignait quelquefois des moments de grande tension, quand les villageois tuaient le bailli ou attaquaient le château du seigneur. » Les motifs de ces « émotions » pouvaient être les taxes et impôts divers (par exemple, il fallait payer – en numéraire ou en nature – pour utiliser le moulin et/ou le four « banal » contrôlé par le seigneur, et il fallait payer une amende si l’on n’utilisait pas ces infrastructures, monopole seigneurial…), les corvées (les heures de travail « dues » au seigneur), la levée de soldats pour les guerres féodales, l’usage des terres « incultes », y compris les bois, les lacs, les collines… Parmi les impôts les plus impopulaires figuraient la taille (une somme fixée arbitrairement par le seigneur) et la dîme, soit le dixième du revenu paysan, destinée au clergé mais souvent collectée par le seigneur.
La conséquence la plus importante des très nombreuses luttes menées par les serfs contre ces formes d’exploitation fut la commutation des services de travail en paiement en argent : de facto, cela signifia la fin du servage mais, loin de représenter une victoire pour les anciens serfs, ce fut une nouvelle défaite pour les plus pauvres d’entre eux, soit la majorité car, contraints de payer leur charges en argent, ils s’endettèrent et perdirent rapidement le peu de terres qu’ils avaient. Cette prolétarisation d’une grande masse de paysans entraîna un exode vers les villes et l’apparition de nombreuses troupes de vagabonds. Les femmes furent très nombreuses à émigrer en ville. Malgré une vie difficile, elles y jouissaient tout de même d’une certaine autonomie, ayant accès à la plupart des professions – et elles occupèrent une place importante dans les mouvements millénaristes et hérétiques. Plus généralement, ce nouveau prolétariat engendré par la commutation représenta la base sociale de ces mouvements.
Les mouvements millénaristes[3] mobilisèrent des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes mais furent assez vite défaits militairement. Par contre, les sectes hérétiques comme celles des vaudois et des cathares, mieux organisées, y compris au niveau « international », plus structurées idéologiquement et porteuses de programmes sociaux révolutionnaires, exercèrent une influence très importante : « L’hérésie était l’équivalent de la “théologie de la libération” pour le prolétariat médiéval. » Elle faisait écho aux revendications de justice sociale et de rénovation spirituelle, contre les inégalités criantes cautionnées par une Église totalement corrompue et « elle propageait une conception nouvelle, révolutionnaire, de la société qui, pour la première fois au Moyen Âge, redéfinissait tous les aspects de la vie quotidienne (travail, propriété, reproduction sexuelle, et la position des femmes), posant la question de l’émancipation en des termes vraiment universels. » Les cathares, en particulier, condamnaient la guerre… et la peine de mort, se montraient tolérants vis-à-vis des autres religions, rejetaient le mariage et la procréation et étaient végétariens, refusant toute nourriture issue de la génération sexuelle. Ces positions étaient les conséquences logiques du dualisme professé par les cathares : selon eux, le monde matériel est le royaume du mal et c’est en se compromettant le moins possible avec les œuvres de la terre et de la chair que l’on peut parvenir au salut. Malgré son aspect extrémiste, cette doctrine rencontrait à l’époque beaucoup de compréhension et de sympathie parmi les pauvres, dont une des préoccupations principales était le contrôle des naissances : en effet, pourquoi mettre au monde des enfants destinés à souffrir de la misère et de la faim ? « Ceci expliquerait pourquoi, quand la croissance de la population devint une question sociale majeure, dans une période de grave crise démographique et de pénurie de main-d’œuvre à la fin du xive siècle, l’hérésie fut associée aux crimes de la reproduction, en particulier la “sodomie”, l’infanticide et l’avortement. » De plus, les doctrines sexuelles des hérétiques remettaient en cause le contrôle, stratégique s’il en fut, de l’Église sur le mariage et la sexualité, contrôle qui soumettait tout individu, puissant ou misérable, à sa stricte discipline.
Dans sa lutte contre l’hérésie, l’Église réactiva d’anciennes dispositions qui jusque-là étaient demeurées à l’état de vœux pieux. Les conciles de Latran de 1123 et 1139 réaffirmèrent avec force l’interdiction du mariage et du concubinage des clercs, et firent du mariage un sacrement, ce qui signifiait qu’il ne pouvait être dissous par aucun pouvoir terrestre. Les attaques contre la « sodomie » s’intensifièrent, visant à la fois les homosexuels et le sexe en dehors de la procréation.
Face à cette offensive, les hérétiques, comme les frères du Saint-Esprit ou les amauriciens, prêchaient que Dieu est en chacun de nous et qu’il nous est donc impossible de pécher. Certain·e·s faisaient même de l’acte sexuel une sorte de rituel mystique. Sans aller jusque-là, les vaudois, par exemple, considéraient que tout le monde pouvait prêcher et exercer le sacerdoce, y compris les femmes. Cela leur valut les persécutions de l’Église, alors que, dans le même temps, les adeptes de Saint-François d’Assise, qui prêchaient la pauvreté et le dénuement volontaire, comme les vaudois, durent à leur respect des règles du clergé de ne pas avoir affaire à l’Inquisition. On assista donc à une politisation de la sexualité, qui devint une véritable affaire d’État et un terrain d’opposition pour les sectes. Ainsi, les femmes furent particulièrement ciblées par l’Inquisition, et plus spécialement les « maléfices »qu’elles mettaient en œuvre pour la contraception ou l’avortement. Cette politique se durcit brutalement lorsque ce contrôle féminin sur la reproduction sembla remettre en cause la stabilité économique et sociale, après la peste noire de 1347-1352, qui causa une diminution de plus d’un tiers de la population européenne. C’est à ce moment-là que les persécuteurs mirent l’accent sur les aspects sexuels de l’hérésie, inventant ce qui allait devenir le sabbat des sorcières, avec des descriptions d’orgies, de scènes de sodomie et de zoophilie, tel le fameux bacium sub cauda (baiser sous la queue) qui fut repris ensuite dans le sabbat comme baiser sur l’anus du diable… C’est aussi à ce moment-là que les inquisiteurs inventent la secte des lucifériens, soit les adorateurs du diable, une trouvaille qui fera florès plus tard au cours des procès des sorcières.
Les mouvements hérétiques trouvèrent aussi beaucoup d’écho parmi le nouveau prolétariat urbain dont les conditions de vie n’étaient souvent guère différentes de celles du servage : ainsi les ouvriers se voyaient interdire toute grève sous peine de mort, ainsi que le port d’armes – y compris d’armes « par destination », comme leurs propres outils professionnels. Il existait déjà d’importantes concentrations de main d’œuvre, dans l’industrie textile, par exemple, et les « bourgeois » des villes n’étaient pas très rassurés face à ces masses inquiétantes. Ils n’avaient d’ailleurs pas tort, puisque de nombreuses révoltes eurent lieu, comme, entre autres, en Flandres, en Allemagne, en Italie. Certaines, qui unirent ouvriers urbains et paysans, furent même parfois victorieuses avant d’être noyées dans le sang : ainsi, à Gand, en 1378, les tisserands « réussirent à établir ce qu’on a appelé (en exagérant peut-être un peu) la première “dictature du prolétariat” connue de l’histoire. » Selon un historien que cite Federici, ces ouvriers s’étaient donné pour objectif de « soulever les compagnons contre les patrons, les salariés contre les grands entrepreneurs, les paysans contre les seigneurs et les clercs. » Ils furent vaincus en 1382 à Roosebecke, dans une bataille rangée qui coûta la vie à 26 000 d’entre eux.
Malgré la répression féroce, les ouvriers et les paysans vécurent tout de même une période plutôt faste vers la fin du xive siècle, « grâce » à la peste noire. Celle-ci produisit en effet, outre un certain nivellement social (les riches comme les pauvres étaient touchés) et une libération éphémère des mœurs (risquant de mourir d’un jour à l’autre, on voulait profiter des plaisirs de la vie, tout de suite), une énorme pénurie de main-d’œuvre, en ville comme à la campagne. Ainsi les travailleurs purent-ils s’émanciper tant soit peu de la tutelle des employeurs. Les salaires augmentèrent, et à la campagne, « des villages entiers s’organisaient pour arrêter de payer les amendes, les impôts et la taille, et ne reconnaissaient plus les services commutés, ou les injonctions des cours de justice seigneuriales, qui étaient le principal instrument du pouvoir féodal. » Les mesures prises par la noblesse ou la bourgeoisie urbaine pour essayer de réduire le coût du travail (y compris, par exemple, le rétablissement de l’esclavage comme à Florence en 1366) ne firent qu’aiguiser les conflits et suscitèrent souvent des révoltes, comme la Révolte paysanne de 1381 en Angleterre, diverses insurrections à Béziers, Montpellier, Carcassonne, Orléans, Amiens, Tournai, Rouen et enfin Paris en 1413, ainsi que celle des Ciompi à Florence.
Cependant, « à la fin du xve siècle, une contre-révolution était déjà en route à tous les niveaux de la vie politique et sociale. Tout d’abord, les autorités politiques s’employèrent à assimiler les travailleurs masculins les plus jeunes et les plus rebelles, au moyen d’une politique sexuelle qui leur procurait du sexe gratuit, et déplaçait le conflit de classe sur le conflit avec les femmes prolétaires. » Ce résultat fut obtenu par la décriminalisation du viol, à condition que les victimes n’appartiennent pas aux classes dominantes. Ainsi, les femmes prolétaires devinrent l’objet des attaques répétées de bandes de jeunes mâles qui savaient très bien que leurs forfaits demeureraient impunis. Federici dit qu’en ville, « en moyenne, la moitié des jeunes hommes de la ville, à un moment ou à un autre, prenaient part à ces agressions […] les résultats furent dévastateurs pour tous les travailleurs, car le viol de femmes pauvres soutenu par l’État sapait la solidarité de classe qui avait été conquise dans la lutte antiféodale. […] La légalisation du viol créa un climat d’intense misogynie qui avilissait toutes les femmes sans distinction de classe. Elle rendait aussi la population insensible à la perpétuation de la violence contre les femmes, jetant les bases de la chasse aux sorcières qui commença à la même époque. » La décriminalisation du viol fut accompagnée d’une intense campagne contre l’homosexualité, assez largement pratiquée alors (au point qu’à Florence, les prostituées portaient des habits masculins pour attirer le client) et de l’encouragement systématique à la prostitution. « Ainsi, entre 1350 et 1450, des bordels gérés par la collectivité, financés par l’impôt, furent ouverts dans chaque ville ou village en Italie et en France, en nombres bien supérieurs à ceux atteints au xixe siècle. Amiens à elle seule comptait 53 bordels en 1453. »
Ce « new deal » sexuel, comme dit Federici, « faisait partie d’un processus plus vaste qui, en réponse à l’intensification des conflits sociaux, conduisit à une centralisation de l’État, unique agent à même de faire face à la généralisation de la lutte et de préserver le rapport de classe. » En fait, ce processus de renforcement et de centralisation étatiques venait cimenter l’alliance passée entre la noblesse, l’Église et la bourgeoisie urbaine contre les rébellions populaires. Ce fut le début de la formation de l’absolutisme, et aussi l’acceptation, par la bourgeoisie urbaine, de la perte de la souveraineté qu’elle avait conquise au sein des cités, en échange d’une protection contre les menaces plébéiennes.
Accumuler le travail et avilir les femmes. Construire la « différence » dans la « transition au capitalisme ».
Marx a établi le concept d’accumulation primitive comme le premier stade du développement du capital, soit la concentration de capital et de travail, et il a montré que c’est la séparation des travailleurs d’avec les moyens de production qui est la source de la richesse capitaliste. Dans sa description, c’est essentiellement l’expropriation terrienne de la paysannerie européenne qui est à la base de l’accumulation primitive, en créant des travailleurs « libres » et indépendants, même s’il parle aussi de la conquête coloniale et de la traite des esclaves africains. Mais, remarque Federici, « on ne trouve nulle part mention dans son œuvre des profondes transformations que le capitalisme introduisit dans la reproduction de la force de travail et la position sociale des femmes. » Marx ne parle pas non plus de la grande chasse aux sorcières des xvie et xviie siècles, « alors que cette campagne de terreur soutenue par l’État joua un rôle essentiel dans la défaite de la paysannerie européenne, facilitant son expulsion de terres qu’elle possédait auparavant en commun. » C’est pourquoi Silvia Federici entend montrer que :
« 1. L’expropriation des travailleurs européens de leurs moyens de subsistance et l’asservissement des Amérindiens et des Africains dans les mines et les plantations du “Nouveau Monde” n’étaient pas les seuls moyens de formation et d’“accumulation”d’un prolétariat mondial.
« 2. Ce processus exigeait la transformation du corps en machine-outil, et la soumission des femmes à la reproduction de la force de travail. Il nécessitait par-dessus tout la destruction du pouvoir des femmes qui, en Europe et en Amérique, fut réalisée au moyen de l’extermination des “sorcières”.
« 3. L’accumulation primitive n’était donc pas seulement une accumulation et une concentration de travailleurs exploitables et de capital. Elle fut aussi une accumulation de différences et de divisions dans la classe ouvrière, au sein de laquelle les hiérarchies reposant sur le genre, tout comme la “race” et l’âge, devinrent partie prenante de la domination de classe et de la formation du prolétariat moderne.
« 4. […] le capitalisme a généré des formes d’asservissement plus brutales et plus insidieuses [qu’avant son apparition], en insérant dans le corps du prolétariat des divisions qui ont servi à intensifier et dissimuler l’exploitation. C’est en grande partie du fait de ces divisions imposées, en particulier celles entre femmes et hommes, que l’accumulation capitaliste continue à dévaster la vie dans chaque recoin de la planète. »
Même si ce ne fut pas le seul moyen d’expropriation des paysans (Federici parle aussi des guerres, de plus en plus dévastatrices, et des conflits liés à la Réforme protestante et à la Contre-Réforme), les enclosures demeurent emblématiques de tout le processus. « Au xvie siècle, enclosure était un terme technique, indiquant un ensemble de stratégies que les seigneurs anglais et les riches fermiers utilisèrent afin d’éliminer la propriété foncière communale et étendre leurs possessions. Il faisait principalement référence à l’abolition du système d’openfield, un arrangement par lequel les villageois détenaient des bandes de terrain non contiguës dans un champ non clôturé. L’enclosure comprenait aussi la division des communaux par des clôtures et la démolition des baraques des paysans pauvres qui ne possédaient pas de terre mais qui pouvaient survivre en ayant accès aux droits coutumiers. De vaste étendues de terre furent aussi encloses afin de créer des réserves de cervidés, et des villages entiers furent détruits, pour servir de pâture. » Des milliers de communes disparurent, au point que la monarchie britannique diligenta des enquêtes à ce sujet en 1518 et 1548.
Il y eut bien sûr une résistance contre ces privatisations. De nombreuses émeutes éclatèrent, toujours réprimées brutalement. On remarque la forte présence féminine dans ces mouvements. En effet, les femmes étaient particulièrement touchées par la disparition des liens communautaires – elles n’avaient guère de solution, comme celle choisie par beaucoup d’hommes jeunes qui s’en allaient vagabonder. Elles avaient aussi souvent des enfants à nourrir, et la dissolution de la communauté signifiait pour elles une exposition dangereuse à la violence masculine, dont elles avaient pu se protéger auparavant grâce à la solidarité féminine villageoise. D’autre part, elles rencontraient plus de difficultés que les hommes pour subvenir à leurs besoins, puisqu’elles étaient de plus en plus assignées au travail reproductif, « au moment même où ce travail était de plus en plus dévalorisé ». « Dans le nouveau régime monétaire, seule la production pour le marché était définie comme activité créatrice de valeur, alors que la reproduction du travailleur commençait à être perçue comme sans valeur d’un point de vue économique, et même cessait d’être prise comme un travail. Le travail reproductif continuait à être payé, quoiqu’aux prix les plus bas, quand il était accompli pour la classe dirigeante ou en dehors du foyer. Mais l’importance économique de la reproduction de la force de travail effectuée dans le foyer et sa fonction dans l’accumulation du capital devint invisible, mythifiée comme “disposition naturelle” et qualifiée de “travail de femme”. En outre, les femmes furent exclues de nombreux emplois salariés et, quand elles travaillaient pour un salaire, elles gagnaient une misère en regard du salaire moyen masculin. »
Autre conséquence de la séparation des travailleurs d’avec leurs moyens de subsistance, les salaires réels diminuèrent – et le travail des femmes fut encore plus dévalorisé. Les prix des matières premières, restés stables pendant deux siècles, commencèrent à augmenter dès que la terre fut privatisée, au point que les historiens parlent de la « révolution des prix » au xvie siècle. L’arrivée en Europe de l’or et de l’argent d’Amérique vint encore renforcer ce phénomène, si bien qu’il fallut des siècles avant que les salaires retrouvent le niveau qu’ils avaient atteint à la fin du Moyen Âge. Là encore, les femmes furent plus touchées que les hommes.
On vit apparaître la malnutrition et des disettes, voire des famines chroniques, dont témoignent, entre autres, les émeutes de la faim recensées aux xvie et xviie siècles (ainsi, un millier d’« émotions » en France entre 1530 et 1670) : « C’étaient habituellement les femmes qui [les] déclenchaient et [les] conduisaient. » Certaines étaient même exclusivement féminines. On retrouve aussi des traces de la lutte pour la nourriture dans les procès faits aux sorcières : en effet, il y était souvent question d’aumônes refusées à l’accusée (après quoi elle aurait jeté un sort pour se venger), ou de chapardage, voire d’attaques de maisons de riches. Des masses de vagabonds erraient sur les routes – on en dénombrait 6 000 à Venise en 1545 – malgré des lois de plus en plus dures, comme celle adoptées en Angleterre, qui prévoyaient en cas de récidive la mise en esclavage et la peine capitale. La criminalité monta en flèche – particulièrement les atteintes aux biens : il n’y avait souvent guère d’autre façon de se nourrir, d’autant moins qu’à l’époque, la condition salariale était encore l’objet d’un mépris quasi universel : en effet, elle était assimilée à une nouvelle forme de servage, et nombre d’hommes préféraient les risques du vagabondage à une servitude à peine rémunérée.
Ici aussi, Federici se distingue de Marx qui parlait de cette période de l’accumulation comme d’une « condition historique préalable » débouchant ensuite sur des formes de capitalisme plus « matures » : car, dit-elle, « la similitude essentielle entre ces phénomènes et les conséquences sociales de la nouvelle phase de mondialisation à laquelle nous assistons nous amène à d’autres conclusions. La paupérisation, la rébellion, et la montée de la “criminalité” sont des éléments structurels de l’accumulation capitaliste, dans la mesure où le capitalisme doit priver la force de travail de tous ses moyens de reproduction pour imposer sa domination. »
Ainsi, la période de « transition » (du féodalisme au capitalisme) présente-t-elle, selon Federici, trois aspects essentiels : a) la création d’une force de travail (plus) disciplinée, b) la réaction contre la contestation sociale et c) la « sédentarisation » des travailleurs dans des emplois auxquels ils avaient été contraints. Ceci se traduisit par une série d’attaques lancées « contre toutes les formes de socialisation et de sexualité collective : les sports, les jeux, les danses, les fêtes, festivals et autres rituels de groupes […] furent réprimées par tout un cortège de lois […] Ce qui était en jeu était la désocialisation et la décollectivisation de la reproduction de la force de travail. […] Même le rapport individuel à Dieu fut privatisé : dans les zones protestantes, par l’institution d’une relation directe entre l’individu et le divin ; dans les zones catholiques, avec l’introduction de la confession individuelle. […] En conséquence, l’enclosure physique qu’opérait la privatisation de la terre et la clôture des communaux fut redoublée par un processus d’enclosure sociale, la reproduction des travailleurs passant de l’openfield au foyer, de la communauté à la famille, de l’espace public (les communaux, l’Église) au privé. »
Deuxième point : entre 1530 et 1560 furent établis des systèmes d’assistance publique dans plus de soixante villes d’Europe – à la fois par les municipalités et l’État central. Qu’il s’agisse d’un réponse « humanitaire » à ce qui était perçu comme une menace grandissante, ou d’une offensive visant à mieux contrôler les pauvres, il faut y voir un tournant décisif : d’une part, c’est une reconnaissance de facto de l’incapacité du système capitaliste à gouverner uniquement par la terreur et la faim, d’autre part, c’est le « premier acte dans la reconstruction de l’État comme garant du rapport de classes et comme superviseur en chef de la reproduction et de la sujétion de la force de travail. »
Enfin, tout un réseau de workhouses et de « maisons de corrections » fut mis en place, véritable système de travail forcé qui présentait le double avantage d’enfermer les travailleurs tout en leur extorquant l’intégralité du produit de leur travaux.
Toutes ces mesures ne purent cependant empêcher l’aggravation de la crise économique et sociale à la fin du xvie siècle, causée en grande partie par l’effondrement démographique en Amérique. Les historiens s’accordent pour constater une baisse de 90 à 95% de la population américaine, au sud comme au nord, soit environ 75 millions d’habitants en moins pour la seule Amérique du sud, ceci un siècle à peine après la « découverte ». En Europe également, on assista à une baisse démographique importante, particulièrement en Allemagne, où elle est estimée à environ 1/3 de la population. C’est durant la même période qu’apparurent les théories économiques mercantilistes, qui associaient puissance d’un État et nombre de ses ressortissants. Aussi, si l’on ne peut pas encore parler, pour cette époque, de politiques d’encouragement aux naissances, on peut cependant parler de politiques natalistes au sens répressif du terme : « […] la principale initiative que prit l’État pour retrouver le niveau démographique désiré fut de livrer une véritable guerre aux femmes visant clairement à briser leur contrôle sur les corps et la reproduction. » Cette guerre allait culminer un peu plus tard avec la chasse aux sorcières, mais les gouvernements européens s’en prirent tout d’abord à la contraception, à l’avortement et à l’infanticide. « En conséquence, les femmes furent persécutées en masse, et il y eut davantage d’exécutions pour infanticide dans l’Europe des xvie et xviie siècles que pour tout autre crime, à l’exception de la sorcellerie, une accusation qui tournait aussi autour du meurtre d’enfants et autres transgressions des normes reproductives. »
Par ailleurs, une offensive eut lieu contre les sages-femmes, afin de les placer sous la tutelle masculine des docteurs et de l’État. « Avec ce changement, une nouvelle pratique médicale allait s’imposer, faisant passer la vie du fœtus avant celle de la mère en cas d’urgence vitale. Une telle pratique était à l’opposé des façons de procéder que les femmes avaient coutume de maîtriser. De fait, pour pouvoir la mettre en place, il fallait tout d’abord congédier la communauté des femmes qui se rassemblait autour du lit de la parturiente […] (c’est moi qui souligne).
« Le résultat de ces politiques, qui s’étendirent sur deux siècles […] fut l’asservissement des femmes à la procréation. Alors qu’au Moyen Âge les femmes avaient pu employer diverses formes de contraception, et avaient exercé un contrôle incontestable sur le processus d’enfantement, leurs utérus, à partir de ce moment-là, devenaient un territoire public, contrôlé par les hommes et l’État, et la procréation était directement mise au service de l’accumulation capitaliste. » Federici ajoute ensuite que, même avec des conditions autrement plus « douces », le destin des femmes occidentales fut comparable à celui des femmes esclaves des plantations américaines : « […] en dépit des différences, dans les deux cas, le corps féminin fut transformé en instrument pour la reproduction du travail et le développement de la force de travail, traité comme une machine à enfanter naturelle, fonctionnant selon des rythmes qui échappaient au contrôle des femmes. »
Une autre stratégie de la guerre misogyne fut d’interdire aux femmes la plupart des emplois hors sphère domestique. Même la prostitution, qui avait été encouragée dans un premier temps comme moyen de division des pauvres, fut réprimée dès lors qu’elle apparut, vers le milieu du xvie siècle, comme l’une des rares possiblités d’autonomie économique pour les femmes. Finalement, les femmes qui osaient encore « travailler hors du foyer, dans un espace public ou sur le marché, étaient représentées comme des mégères sexuellement agressives, ou même comme des “putains” et des “sorcières”. »
Ainsi fut établie une nouvelle division sexuelle du travail, ou même un nouveau « contrat sexuel », « définisssant les femmes en des termes (mères, épouses, filles, veuves) qui dissimulaient leur statut de travailleuses, tout en donnant aux hommes libre accès au corps des femmes, à leur travail, au corps et au travail de leurs enfants. […] Dans la nouvelle organisation du travail chaque femme (à part celles qui étaient privatisées par les bourgeois) devenait un bien commun, dans la mesure où, dès lors que leurs activités étaient définies comme du non-travail, leur travail commençait à apparaître comme une ressource naturelle, disponible à tous, tout comme l’air qu’on respire ou l’eau que l’on boit. « Ce fut pour les femmes une défaite historique. […] Le fait que des rapports de pouvoir inégaux entre hommes et femmes aient existé avant même l’apparition du capitalisme, tout comme existait une division du travail discriminatoire, ne diminue en rien cette constatation. Dans l’Europe précapitaliste, la subordination des femmes aux hommes était modérée par le fait qu’ils avaient accès aux communaux, alors que dans le nouveau régime capitaliste les femmes elles-mêmes devenaient les communaux, dès lors que leur travail était défini comme ressource naturelle, en dehors de la sphère des rapports marchands.
Durant toute cette période de la guerre faite aux femmes, « il n’est pas exagéré de dire, poursuit Federici, que les femmes étaient traitées avec la même hostilité et la même aversion manifestée envers les “sauvages indiens” dans la littérature qui s’écrivit à ce propos après la conquête. Le parallèle n’est pas anodin. Dans les deux cas, le dénigrement littéraire et culturel était au service d’un projet d’expropriation. […] la diabolisation des peuples indigènes américains servit à justifier leur asservissement et le pillage de leurs ressources. En Europe, l’attaque menée contre les femmes justifia l’appropriation de leur travail par les hommes et la criminalisation de leur emprise sur la reproduction. À chaque fois, le prix de la résistance était l’extermination. » Ainsi, après deux siècles de terrorisme d’État, émergea « un nouveau modèle de féminité : la femme et l’épouse idéale, passive, obéissante, économe, taiseuse, travailleuse et chaste. […] Alors que durant la chasse aux sorcières les femmes avaient été représentées comme des sauvages, débiles, insatiablement luxurieuses, incapables de se dominer, le modèle devait se renverser au xviiie siècle. Elles étaient alors dépeintes comme passives, asexuées, plus obéissantes et plus intègres que les hommes, capables d’avoir sur eux une influence morale positive. »
En réaction à l’effondrement démographique aux Amériques, les colons européens inventèrent le système du « commerce triangulaire », autrement dit la traite des esclaves entre l’Afrique et l’Amérique. « […] la plantation fut une étape essentielle de la division internationale du travail qui, par la production de “biens de consommation”, intégrait le travail des esclaves dans la reproduction de la force de travail européenne, tout en maintenant travailleurs salariés et esclaves géographiquement et socialement séparés. […] au moment où [l’esclavage] se développa, deux mécanismes furent introduits qui restructurèrent de façon significative la reproduction du travail à l’échelle internationale. D’une part, une chaîne d’assemblage mondiale fut créée qui abaissa le coût des biens nécessaires à la production de la force de travail en Europe, et qui connecta les travailleurs salariés aux esclaves d’une façon qui préfigurait l’utilisation actuelle par le capitalisme des travailleurs asiatiques, africains et sud-américains comme fournisseurs de biens de “consommation” à bon marché (rendus bon marché par des escadrons de la mort et la violence militaire) à destination des pays capitalistes “avancés”.
« D’un autre côté, le salaire en métropole devint le moyen par lequel les biens produits par les esclaves étaient amenés sur le marché, et la valeur des produits du travail esclave était réalisée. De la sorte, comme avec le travail domestique féminin, l’intégration du travail esclave dans la production et la reproduction de la force de travail métropoplitaine était encore mieux réalisée, et le salaire était redéfini comme instrument d’accumulation, c’est-à-dire comme un levier permettant de mobiliser non seulement le travail des ouvriers qu’il payait, mais aussi le travail d’une multitude d’ouvriers qu’il dissimulait, du fait des conditions de leur travail, non salarié. »
Et, comme on menait campagne en Europe contre les femmes, on mena campagne en Amérique contre les Noirs, en instaurant le caractère héréditaire de l’esclavage et le droit pour les maîtres de battre et de tuer leurs esclaves, en interdisant les mariages mixtes et en abolissant les anciens statuts de servitude des Blancs engagés en indenture, un contrat s’apparentant au servage et datant des premiers temps de la colonisation. On instaura ainsi un racisme structurel et une assimilation indélébile entre « Noirs » et esclaves. En Amérique du sud, le processus fut un peu plus compliqué à cause de la présence de métis issus de Blancs et d’Indiens, de Blancs et de Noirs, de Noirs et d’Indiens… mais une hiérarchie très stricte fut établie, établissant qui était Blanc et qui ne l’était pas, et réservant tous les privilèges aux premiers.
En conclusion de cette deuxième partie, Silvia Federici écrit que « l’accumulation primitive a ainsi été tout d’abord une accumulation de différences, d’inégalités, de hiérarchies, de divisions, qui ont aliéné les travailleurs les uns des autres et souvent d’eux-mêmes. » C’est cette aliénation qu’elle nomme finalement une « “désaccumulation primitive” de leur propre pouvoir collectif et individuel. »
Le grand Caliban. La lutte contre le corps rebelle
La mise au pas des prolétaires et leur transformation en ouvriers disciplinés et fiers de leur travail se heurta à une farouche résistance – il fallut bien deux ou trois siècles pour la briser, tout en déployant les moyens les plus brutaux. Ainsi, dans la seule Angleterre, 72 000 personnes furent pendues durant les trente-huit ans du règne de Henry VIII (1509-1547). Cette violence ne visait pas les seuls délinquants, mais bien « une transformation radicale de la personne », cherchant à « éradiquer du prolétariat tout comportement résistant à l’introduction d’une discipline au travail plus stricte. » En même temps que les diverses mesures (contre les jeux de hasard, les fêtes, la nudité, la sexualité « improductive », etc.) prises par les classes dominantes, et la transformation en profondeur des rapports sociaux qu’elles impliquaient, « un nouveau concept du corps et une nouvelle attitude à son égard commencèrent à prendre forme ». Le corps comme image du prolétariat effrayait les riches, les bourgeois et les autorités politiques, toujours menacées par de possibles émeutes. Mais il était aussi perçu comme l’une des principales sources de profit, « le réceptacle de la force de travail, un moyen de production, la machine-travail primitive ». Aussi, « l’étude de ses propriétés et de ses mouvements corporels devint le point de départ de la plupart des théories spéculatives de l’époque ». L’un des axes principaux de ces théories était la mécanique du corps. Selon ces représentations, le corps ne serait rien d’autre qu’une machine obéissant plus ou moins bien à l’âme – ou l’esprit, la conscience, etc. Federici pointe ici une différence importante entre Hobbes et Descartes. D’après ce dernier, en effet, l’homme est doté d’une âme raisonnable qui peut, sinon empêcher, du moins réguler et contenir les passions corporelles. Moins confiant dans la nature humaine, Hobbes préfère déléguer cette tâche à Léviathan, soit l’État terroriste, seul capable d’empêcher la « guerre de tous contre tous ». « Poser le corps en termes de mécanique, vide de toute téléologie intrinsèque, ces “vertus occultes” que lui attribuaient autant la magie naturelle que les superstitions populaires de l’époque, permit de rendre intelligible la possibilité de le subordonner à un procès de travail reposant de façon croissante sur des comportements uniformes et prévisibles.
[…] On pouvait [dès lors] chercher les vices et les limites de l’imagination, les vertus de l’habitude, les usages de la peur, de quelles manières certaines passions pouvaient être évitées ou rationalisées, et comment les utiliser plus rationnellement. » Les xvie et xviie siècles virent ainsi le développement d’une véritable alchimie sociale qui ne cherchait plus à transformer les métaux en or, mais les dispositions corporelles en dispositions au travail. Federici fait ensuite un parallèle entre les rapports introduits par le capitalisme entre la terre et le travail et entre le corps et le travail : « Tout comme la terre, le corps devait être cultivé et en premier lieu disloqué, de sorte qu’il révèle ses trésors cachés. Pour autant que le corps est la condition d’existence de la force de travail, il en est aussi la limite, en tant qu’élément principal de résistance à sa dépense. Il était par conséquent insuffisant de décider qu’en lui-même le corps n’avait aucune valeur. Le corps se devait de mourir pour que vive la force de travail.
« La conception du corps en tant que réceptacle de pouvoirs magiques qui avait prévalu dans le monde médiéval était morte. En réalité, elle avait été détruite. Derrière cette nouvelle philosophie, nous devinons une vaste initiative de l’État, par laquelle ce que les philosophes qualifièrent d’irrationnel fut déclaré criminel. Cette intervention de l’État était le “sous-texte” de la philosophie mécaniste. Le “savoir” ne saurait devenir “pouvoir” que s’il peut faire appliquer ses prescriptions. Cela signifie que le corps mécanique, le corps-machine, ne pouvait devenir un modèle de comportement social sans que l’État ne détruise toute une variété de comportements, de pratiques, et sujets sociaux précapitalistes dont l’existence entrait en contradiction avec l’attitude corporelle promise par la philosophie mécaniste. C’est pourquoi à l’apogée de l’“âge de la Raison”, l’âge du scepticisme et du doute méthodologique, nous avons une féroce attaque du corps […] »
C’est aussi le contexte idéologique de la chasse aux sorcières, et plus généralement de l’offensive contre la conception animiste de la nature héritée du Moyen Âge, conception qui ne posait aucune séparation entre matière et esprit et représentait « le cosmos comme un organisme vivant, peuplé de forces occultes, dont chaque élément était en relation de “communion” avec le reste. » D’où les pratiques magiques qui consistaient à se servir des affinités entre différents élements des règnes minéral, végétal et animal afin d’obtenir des résultats en matière de santé, d’amour, de pouvoirs extraordinaires, etc. « L’éradication de ces pratiques était une condition nécessaire à la rationalisation capitaliste du pouvoir, parce que la magie apparaissait comme une forme illicite de pouvoir et un instrument pour obtenir ce que l’on voulait sans travail, c’est-à-dire le refus du travail en action. » C’est pourquoi l’État lança une campagne de terreur contre la magie – rebaptisée « sorcellerie » –, campagne largement soutenue par les esprits « éclairés » de l’époque, comme Hobbes, Mersenne ou Jean Bodin qui, à côté de ses travaux de philosophie politique (les six livres de la République) publia aussi un traité… de démonologie.
La production de ce corps nouveau, coupé de ses anciennes connexions, entraîna évidemment d’importantes conséquences. « Comme Foucault l’a montré, poursuit Federici, la mécanisation du corps n’implique pas seulement la répression des désirs, des émotions, ou des formes de comportement qui devaient être éradiquées. Cela impliquait également le développement de nouvelles facultés chez l’individu qui apparaissent comme autres que le corps lui-même, et deviennent les agents de sa transformation. Le produit de cette aliénation du corps était, en d’autres termes, le développement de l’identité individuelle, conçue précisément comme “altérité” du corps, et en antagonisme perpétuel avec lui.
« L’émergence de cet alter ego, et la détermination d’un conflit historique entre l’esprit et le corps, représentent la naissance de l’individu dans la société capitaliste. Confronter son corps comme une réalité étrangère à évaluer, développée et tenue à distance afin d’en tirer les résultats escomptés, allait devenir la caractéristique typique de l’individu façonné par la discipline capitaliste du travail. »
Mais il faut souligner que cette « gestion de soi » demeura longtemps l’apanage des classes dominantes. Le prolétariat, quant à lui, était vu comme un corps monstrueux, une bête fauve à dompter. « Dans ce processus, le corps ne perdit pas seulement toute connotation naturelle, une fonction-corps commença d’émerger, dans le sens où le corps devint un terme purement relationnel, ne signifiant plus aucune réalité spécifique, caractérisant plutôt tout obstacle à la domination de la raison. [C’est moi qui souligne : jamais l’expression « corps étranger » ne m’a paru plus pertinente.] Cela signifie que tandis que le prolétariat devenait “corps”, le corps devenait “le prolétariat” et plus particulièrement la faible et irrationnelle femelle (la “femme en nous”, comme le dit Hamlet) ou le “sauvage” africain, étant purement défini au travers des limites de sa fonction, du fait de son “altérité” à la raison et traité comme un agent de subversion interne. »
La grande chasse aux sorcières en Europe
La chasse aux sorcières a jusqu’ici peu mobilisé la corporation historienne – et elle n’apparaît pas du tout dans l’analyse de Marx sur la « transition » entre féodalisme et capitalisme. En l’absence de recensement systématique, il est difficile d’en établir un bilan précis, mais celles et ceux qui ont travaillé sur le sujet s’accordent tout de même pour estimer à plusieurs centaines de milliers les accusées de sorcellerie, et à peu près autant d’exécutées. Même en cas d’efforts de recherche sérieux et coordonnés à l’échelle européenne, on aboutirait probablement à une estimation plutôt inférieure à la réalité, car toutes les persécutions n’ont pas fait l’objet de procès, nombre de « sorcières » sont mortes sous la torture et leur décès n’ont pas été enregistrés comme tels et, de plus, beaucoup de registres judiciaires ont disparu.
Durant tout le Moyen Âge, les sorcières n’avaient pas été inquiétées. C’est vers le milieu du xve siècle que se tiennent les premiers procès en France, Suisse, Allemagne et Italie, et c’est aussi à ce moment-là que paraissent les premiers traités de (en fait contre la) sorcellerie : vingt-huit entre 1435 et 1487, avec pour « best-seller » le tristement célèbre Le Marteau des sorcières (Malleus Maleficarum), ce qui fait probablement de ce thème l’un des plus traités par les premiers livres imprimés. L’invention de l’imprimerie ne va pas peu contribuer à l’extension du réseau des chasseurs de sorcières… Ainsi, contrairement à une image simpliste trop souvent admise, la chasse aux sorcières, loin d’être une pratique moyenâgeuse, est contemporaine de changements qui vont conduire à ce que l’on a nommé plus tard l’époque des Lumières. En même temps que ce déferlement éditorial, le pape Innocent VIII commet la bulle Summis desirantes (1484) qui légitime la persécution, approuvant les théories élaborées par l’Inquisition sur une secte d’adorateurs du diable à combattre sans miséricorde aucune. Mais partout, ce sont les autorités séculières qui vont mener les procès. Des lois appelant la population à dénoncer les sorcières et, surtout, criminalisant la sorcellerie en tant que telle, et non tel ou tel dommage qu’elle aurait pu causer, sont édictées dans la plupart des pays européens dès la fin du xve siècle ou le début du xvie. Federici insiste sur le fait que la chasse aux sorcières ne fut pas le résultat d’un mouvement spontané, d’une panique des populations à laquelle auraient répondu les autorités. C’est bien l’inverse qui se produisit, comme le montre, entre autres, la mise en place de toute une logistique organisationnelle et administrative. Les autorités incitaient leurs administrés à la délation, les juges et leurs assesseurs (ceux qui appliquaient la « question », soit la torture) se formèrent grâce aux livres déjà cités et aux premiers compte-rendus de procès, tout ce monde devait être payé (les procès et les bourreaux coûtaient cher), bref, l’ensemble ne pouvait guère être improvisé. « La chasse aux sorcières, dit Federici, fut aussi la première persécution en Europe qui utilisa pour sa propagande tous les médias afin de susciter au sein de la population une psychose de masse. » On vit ainsi se multiplier les brochures imprimées « rendant publics les procès les plus célèbres et leurs détails atroces. Des artistes furent recrutés pour cette tâche, parmi eux l’Allemand Hans Baldung à qui l’on doit les portraits de sorcières les plus accablants. » Mais il y eut aussi les juristes, les magistrats, les démonologues dont la participation fut déterminante. Les intellectuels les plus réputés de l’époque approuvèrent les persécutions. Ainsi Jean Bodin, « célèbre juriste français et théoricien politique », demanda dans son De la démonomanie des sorciers que les sorcières soient brûlées vives plutôt que d’être « généreusement » étranglées avant d’être mises au bûcher.
Tous ces éléments assemblés signalent la nature politique de la chasse aux sorcières, qui s’exerça dans les nations réformées comme chez les catholiques. Ainsi, « il n’est pas exagéré de dire que la chasse aux sorcières fut le premier point d’unification dans la politique des nouveaux États-nations européens, le premier exemple, après le schisme amené par la Réforme, d’une unification européenne. »
Mais pourquoi ce déchaînement de violence dirigée essentiellement contre des femmes (plus de 80% des victimes) et particulièrement contre des femmes âgées ? Selon Federici, c’est parce que les femmes étaient plus attachées aux (et plus dépendantes des) anciennes communautés villageoises que la privatisation des terres et la monétarisation des rapports sociaux tendaient à liquider : « la chasse aux sorcières, dit-elle, ne visait pas des crimes socialement condamnés, mais des pratiques et des groupes de personnes auparavant intégrées qui devaient alors être éradiqués […] par la terreur et la criminalisation. » A contrario, des régions comme l’Irlande et les Highlands (hautes-terres de l’Ouest de l’Écosse), où la privatisation des terres n’avait pas eu lieu et n’était pas à l’ordre du jour, ne connurent aucune persécution. L’un des motifs récurrents qui apparaissent dans les procès est celui de la vieille femme misérable (une fois disparues les anciennes ressources communales, les femmes âgées, souvent veuves, se retrouvaient dans un dénuement extrême et se voyaient réduites à la mendicité) à qui l’on a refusé une aumône, ou le don d’un peu de bois ou de nourriture, et que l’on accuse ensuite d’avoir jeté un sort sur le bétail ou sur des personnes afin de se venger. Mais les persécutions ne visaient pas seulement des personnes. Il s’agissait aussi d’éradiquer des pratiques et des croyances, et spécialement les pratiques et croyances magiques, qui n’étaient pas compatibles avec la nouvelle organisation capitaliste du travail : « La magie était […] un obstacle à la rationalisation du procès de travail et une menace pour l’établissement du principe de responsabilité individuelle. En outre, [elle] paraissait être une forme de refus du travail, d’insubordination, et un instrument de résistance au pouvoir par la base. Le monde devait être “désenchanté” pour être dominé. »
Parmi les pratiques spécifiquement féminines visées, l’avortement et la contraception tiennent une place de choix dans les procès. Il s’agissait bien d’exproprier les femmes de leur contrôle sur les fonctions reproductives, et de mettre leur corps au service des hommes et de l’État. Ainsi, « ce n’était pas seulement la femme déviante, mais la femme en tant que telle, particulièrement la femme des classes inférieures, qui était jugée […] » D’ailleurs, la chasse aux sorcières n’est que la monstruosité la plus voyante d’une époque qui vit se déployer une offensive généralisée contre les femmes. Au niveau idéologique, cette offensive se traduisit par l’apparition d’une image (fortement inspirée par les procès des sorcières) stéréotype de la femme faible de corps et d’esprit et biologiquement sujette au mal, image qui justifia le contrôle des hommes sur les femmes ainsi que le nouvel ordre patriarcal. La domination masculine sortit renforcée de la chasse aux sorcières, non toutefois sans concéder d’étranges pouvoirs aux femmes. En effet, si celles-ci sont soumises à leur maître le diable (masculin) comme elle devraient l’être à leur mari, la contrepartie que leur accorde Satan est effrayante pour la gent masculine : ainsi, elles sont capables de rendre les hommes stériles (de leur « nouer l’aiguillette », disait-on) et, au prix de sacrifices d’enfants et de préparation d’onguents à base de bébés, elles peuvent disparaître la nuit du lit conjugal à l’insu de leur mari et, enfourchant un balai, de s’envoler vers le sabbat des sorcières, souvent assez loin de chez elles, puis de rentrer à la maison, le tout sans que personne ne s’en aperçoive… Ce qui simplifie évidemment la tâche des juges : car s’il n’y a pas de témoignage visuel, c’est bien parce que l’accusée est une sorcière. Piège… infernal tendu aux femmes et qui contribuera puissamment à instiller le poison de la défiance envers toutes les femmes, et par là à achever la destruction des anciens liens communautaires villageois, accélérant encore le processus qui vit naître l’individu « libre » de toute attache, condition sine qua non de l’exploitation capitaliste.
L’une des armes les plus redoutables dont étaient dotées les femmes de par leur nature… diabolique était leur sexualité et leur capacité à « entraîn[er] l’esprit des hommes à un amour désordonné ». Ainsi, d’un côté on accusait les sorcières – bientôt les femmes en général – d’être des castratrices « noueuses d’aiguillettes », voleuses de pénis (qu’elles élevaient ensuite dans des nids perchés sur des arbres, ainsi que l’indiquent bon nombre de très sérieux traités de sorcellerie), et de l’autre de perdre les hommes dans les affres de la passion sexuelle, ce qui revenait au même finalement : en effet, selon les démonologues et autres « gens de bien », un homme castré ou un amoureux transi étaient l’un comme l’autre impuissants fonctionnellement, c’est-à-dire incapable d’exercer leur souveraineté sur leur épouse et leur famille. « La passion sexuelle ne remettait pas seulement en cause l’autorité masculine sur les femmes – Montaigne déplorait qu’un homme puisse préserver les apparences en toute occasion, sauf dans l’acte sexuel – mais elle bousculait aussi la capacité de l’homme à se gouverner lui-même, lui faisant perdre cette précieuse tête où la philosophie localisait la source de la raison. Une femme sexuellement active était alors un danger public, une menace à l’ordre social puisqu’elle subvertissait le sens des responsabilités de l’homme, sa capacité au travail et son contrôle de soi. Pour que les femmes ne ruinent pas les hommes moralement, et surtout, financièrement, la sexualité des femmes devait être exorcisée. Cela passait par des tortures, l’immolation, tout comme par les interrogatoires méticuleux auxquels les sorcières étaient soumises, mélange d’exorcisme sexuel et de viol psychologique. » Federici cite en note, à ce propos, Carolyn Merchant[4] qui « affirme que les interrogatoires et les tortures des sorcières furent un modèle pour la méthodologie de la nouvelle science, telle que définie par Francis Bacon : “La plupart de l’imagerie que Bacon utilise pour délimiter sa méthode et ses objectifs viennent des tribunaux. En traitant la nature comme une femme que l’on devrait torturer avec des inventions mécaniques, cela fait fortement référence aux interrogatoires des sorcières et aux machines utilisées pour les torturer. Dans un passage éloquent, Bacon affirme que la méthode par laquelle on peut percer les secrets de la nature est la même que celle des enquêtes de l’Inquisition sur la sorcellerie.” »
Ici, Federici critique Michel Foucault qui, à l’instar de Marx, « ignore de manière surprenante » la chasse aux sorcières dans son Histoire de la sexualité. En termes foucaldiens, on peut dire « que le langage de la chasse aux sorcières “produisit” la femme comme une espèce différente, un être sui generis, plus charnel et perverti de nature. [On peut] dire aussi que la production de la “perverse” était une étape dans la transformation de la femme vis erotica en vis laborativa – une première étape dans la transformation de la sexualité féminine en travail. Mais il faut observer le caractère destructif de ce processus qui démontre les limites d’une “histoire de la sexualité” générale du genre de celle que Foucault a proposée, traitant la sexualité du point de vue d’un sujet indifférencié, non genré, et comme une activité dont on présume qu’elle a les mêmes conséquences pour les hommes que pour les femmes. »
La conséquence pour les femmes fut « l’interdiction de toutes activités sexuelles non productives ou non procréatrices, potentiellement démoniaques et antisociales ». Ces dernières étaient bien symbolisées par l’image de la vieille sorcière sur son balai – ou sur des animaux –, autant de projections de pénis en extension. « Cette imagerie trahit une nouvelle discipline sexuelle, qui déniait à la femme “vieille et laide”, ayant perdu sa fertilité, le droit à une vie sexuelle. » Alors qu’auparavant, la femme âgée avait été considérée comme une femme savante, car elle incarnait le savoir et la mémoire de la communauté, elle devint symbole de stérilité et d’hostilité à la vie.
Autre thématique des procès en sorcellerie, l’identification récurrente de la sexualité féminine à la bestialité. Dans le sabbat, les sorcières baisent le diable-bouc sub cauda avant de s’unir charnellement à lui. D’autre part, tout un bestiaire les entoure, qui les aide à commettre leurs crimes. « À une époque où l’on commençait à idolâtrer la raison et à dissocier l’humain du corporel, les animaux étaient aussi sujets à une dévalorisation sévère, réduits à n’être que bêtes, l’“autre” par excellence, symbole éternel des pires instincts humains. […] la présence animale excessive dans la vie des sorcières suggère aussi que les femmes se trouvaient à un croisement (glissant) entre homme et animal, et que non seulement la sexualité féminine, mais la féminité en tant que telle, était assimilable à l’animalité. »
Colonisation et christianisation. Caliban et les sorcières du Nouveau Monde
En Europe, les inquisiteurs avaient de longue date accusé les hérétiques, les musulmans et les juifs d’être des sodomites, des adorateurs du diable, etc. Ils firent de même avec les peuples africains et amérindiens. Entre autres éléments à charge, le fait que ces gens se montraient « prêts à tout donner en échange de choses de peu de valeur » permettait de les considérer comme des bêtes de somme, plus près de l’animal que de l’humain. Des cas de cannibalisme rituel furent montés en épingle pour démontrer, s’il en était besoin, que ces populations étaient sous le contrôle du diable, et qu’il était donc légitime de les réduire en esclavage ou de les massacrer. Pourtant, précise Federici, ces rituels, « qui occupent une bonne place dans les récits de la conquête, n’ont pas dû être bien différents des pratiques médicales alors populaires en Europe. Au xvie, xviie, et même xviiie siècle, boire du sang humain (particulièrement lorsque le sang était récolté après une mort violente) et du jus de momie (qu’on obtenait par macération de chair humaine dans diverses liqueurs) étaient des remèdes courants pour traiter l’épilepsie et autres maladies dans de nombreux pays européens. »
Le besoin toujours plus pressant d’or et d’argent en provenance du Nouveau Monde conduisit la couronne d’Espagne à durcir encore l’exploitation des populations indigènes contraintes à travailler dans les mines. Mais une résistance à la colonisation commençait à prendre forme. C’est pour briser cette résistance que fut déclarée la guerre aux cultures indigènes du Mexique et du Pérou. Au Mexique, en 1562, le supérieur jésuite de la province lança une campagne contre l’idolâtrie dans la péninsule du Yucatan : plus de 4 500 personnes furent capturées et torturées sous l’inculpation de pratique du sacrifice humain. Beaucoup en moururent ou restèrent invalides. À peu près au même moment, au Pérou, les persécutions se déchaînèrent en réponse au mouvement Taki Ongoy, un mouvement millénariste indigène qui prônait l’opposition à la collaboration avec les Européens et la poursuite des cultes rendus aux dieux traditionnels (les huacas). L’objectif poursuivi, comme en Europe, était la destruction des liens qui reliaient les gens entre eux et avec leur environnement naturel. Ces pratiques et ces croyances étaient qualifiées de diaboliques par les inquisiteurs et, parce que c’étaient souvent les femmes qui animaient la résistance, on vit s’ouvrir, là-bas aussi, une véritable chasse aux sorcières. On peut d’ailleurs observer, selon Federici, de nombreuses correspondances entre les chasses européennes et américaines – les mêmes motifs qui reviennent, tels le sabbat, les poisons, etc., et des ressemblances frappantes entre les iconographies consacrées aux sorcières d’Europe et d’Amérique.
Les chasses aux sorcières en Amérique se sont poursuivies par vagues jusqu’à la fin du xviie siècle, principalement dans les pays de plantations esclavagistes. Cependant, Silvia Federici constate que cette pratique n’a pas disparu avec l’abolition de l’esclavage. « Au contraire, dit-elle, l’expansion mondiale du capitalisme à travers la colonisation et la christianisation a assuré l’inscription de cette persécution dans le corps des sociétés colonisées. Avec le temps, [elle] fut même menée par les communautés assujetties elles-mêmes contre leurs propres membres. » Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, on assiste à des chasses aux sorcières, souvent provoquées par une « concurrence désepérée pour des ressources limitées », dans le contexte de l’imposition partout du programme néolibéral. Au Transvaal sud-africain, soixante-dix femmes, pour la plupart vieilles et pauvres, furent brûlées entre janvier et avril 1994. « On a aussi mentionné des chasses aux sorcières au Kenya, au Nigeria et au Cameroun dans les années 1980 et 1990. Elles sont concomittantes de la mise en place de la politique d’ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui a entraîné un nouvel enfermement et a causé une paupérisation de la population sans précédent.
« […] si l’on tire les leçons du passé, on réalise que la réapparition des chasses aux sorcières dans de nombreuses parties du monde au cours des années 1980 et 1990 est un signe évident du processus d’“accumulation primitive”. Cela signifie que la privatisation de la terre et des ressources communales, la paupérisation des masses, le pillage et la discorde dans des communautés qui étaient unies sont à nouveau au programme, à l’échelle mondiale. »
François, le 23 août 2014
[1] Ces quelques éléments sont extraits de « Remarques sur les notions de “valeur” et de “dissociation-valeur” ». Texte paru dans la revue Illusio n° 4/5, automne 2007 : Libido. Sexes, genres et dominations. Traduction de l’allemand par Johannes Vogele d’un extrait du livre de Roswitha Scholtz, Das Geschlecht des Kapitalismus [Le Sexe du capitalisme]. Feministische Theorien und die postmoderne Metamorphose des Patriarchats, Bad Honnef, Horlemann, 2000.
[2] Le texte de cette première partie est lisible sur le site de la revue en ligne Période : http://revueperiode.net/il-faut-a-tout-ce-monde-un-grand-coup-de-fouet-mouvements-sociaux-et-crise-politique-dans-leurope-medievale/
[3] Voir L’Incendie millénariste, de Yves Delhoisie et Georges Lapierre, Os Cangaceiros, 1987 et Le Mouvement du libre-esprit, Raoul Vaneigem, Ramsay, 1986, rééd. L’or des fous.
[4] C. Merchant, The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, New York, Harper and Row, 1980.