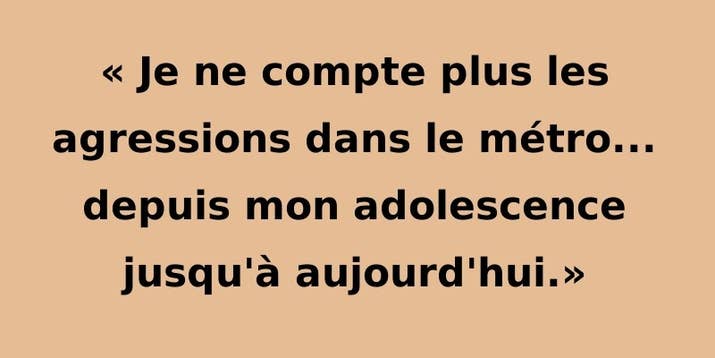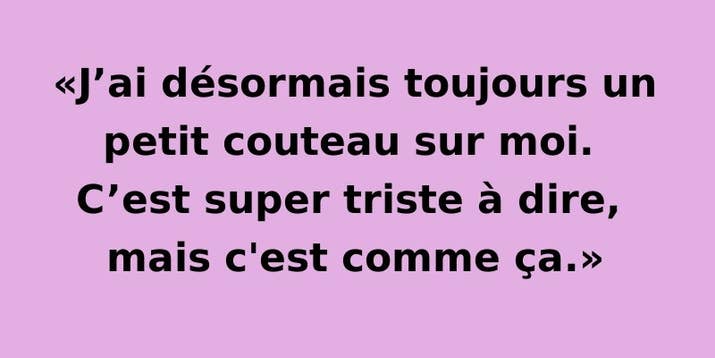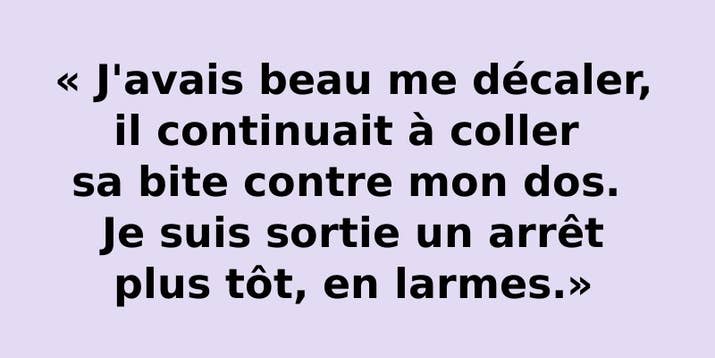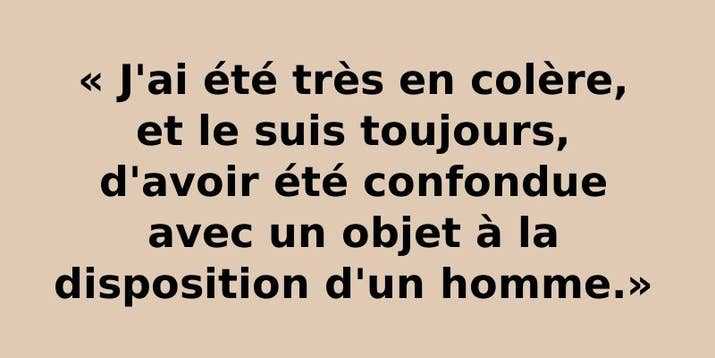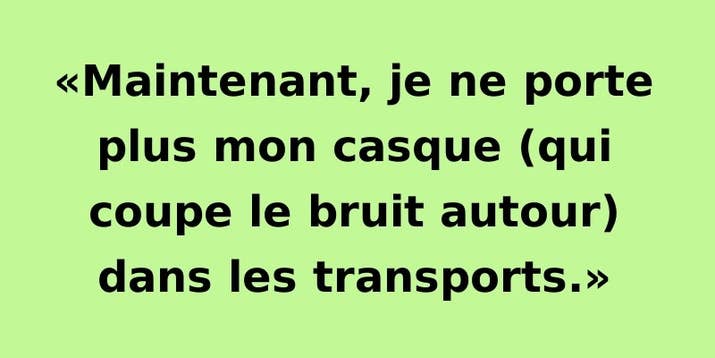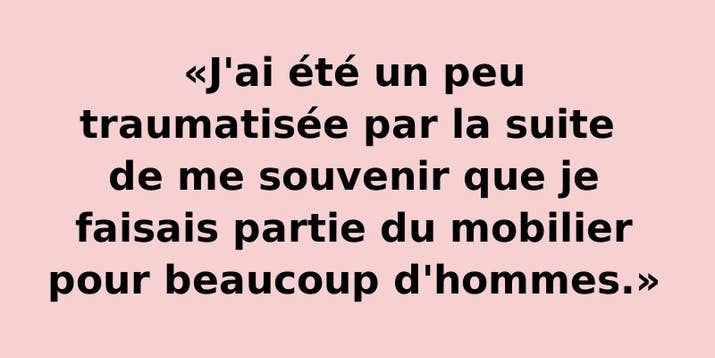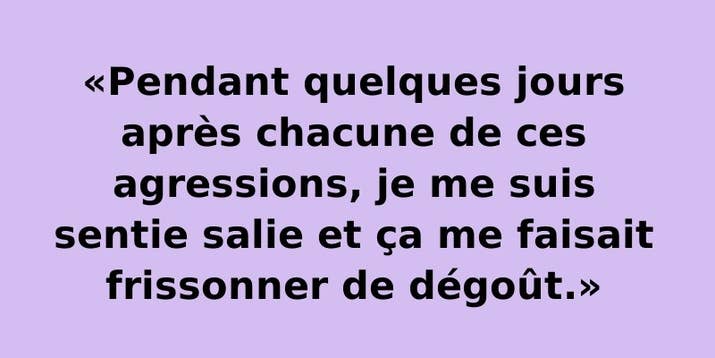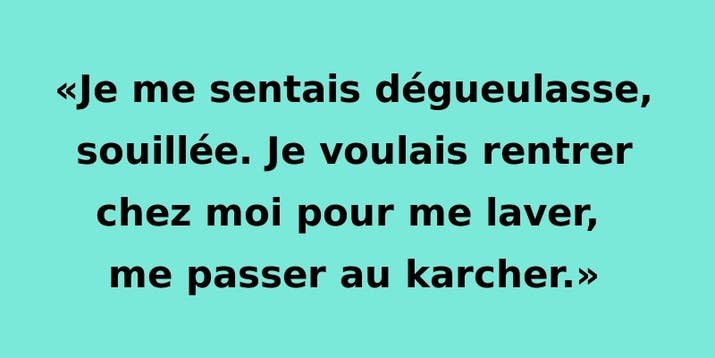En tant que cadre libératoire émergeant du mouvement kurde, la jinéologie place la femme au centre de la lutte contre le patriarcat, le capitalisme et l’Etat.
Suite aux récents développements dans le nord de la Syrie, les médias occidentaux ont souvent dépeint les femmes kurdes comme de féroces combattantes luttant contre les barbares du soi-disant État islamique. Mais considérer les femmes kurdes guérilleras comme des héroïnes défendant les valeurs occidentales de la démocratie et de l’égalité des sexes, toutefois, place les femmes kurdes dans un récit orientaliste qui n’accorde une valeur politique et une reconnaissance qu’aussi longtemps que leurs actions correspondent aux valeurs libérales occidentales.
Pourtant, la lutte que mènent les femmes kurdes est profondément enracinée dans une pensée et une pratique politiques radicales et, en tant que telle, elle ne se prête pas aussi facilement qu’il n’y paraît à la vision libérale et occidentale du monde. Le mouvement kurde est né à la fin des années 70 à partir d’une gauche turque fragmentée et radicalisée par les salles de torture des prisons de Diyarbakir à la suite du coup d’État militaire de 1980 en Turquie. Depuis sa création, elle a évolué d’un cocon marxiste-léniniste dogmatique à un papillon démocratique radical.
Abandonnant l’objectif d’un Kurdistan socialiste indépendant, le mouvement s’appuie désormais sur la théorie et la pratique du féminisme, de l’écologie sociale et du municipalisme libertaire pour transcender l’Etat. Au lieu de centraliser le pouvoir, il cherche à le redistribuer à la base par des formes de représentation horizontales. En partie inspiré par le théoricien communaliste étatsunien Murray Bookchin, le mouvement kurde a clairement exprimé ses aspirations pour une société post-capitaliste et post-étatique et a commencé à mettre en œuvre ces idées dans les régions autonomes kurdes du Rojava, dans le nord de la Syrie.
La lutte pour l’égalité des sexes est au cœur de la vision du mouvement kurde en faveur d’une société juste. En situant la racine historique des oppressions et des injustices sociales, économiques et culturelles dans l’émergence des hiérarchies de genre au Néolithique, Abdullah Öcalan, leader emprisonné et théoricien en chef du mouvement kurde, affirme l’existence d’une relation directe entre les hiérarchies de genre et la formation de l’Etat. Se référant aux femmes en tant que “première colonie”, Öcalan soutient que l’État-nation, les religions monothéistes et le capitalisme constituent tous différentes formes institutionnalisées de la domination par l’homme. Combattre les structures sociales patriarcales – ou, pour reprendre les mots d’Öcalan, “tuer le mâle dominant” – devient donc un impératif dans la lutte pour une société qui transcendera les structures oppressives de l’État-nation capitaliste.
Dans le cadre de cette lutte, le paradigme kurde souligne l’importance d’une transformation durable des mentalités sociales et personnelles, des termes qui entrent en résonance avec le concept foucauldien du discours comme formation globale de la pensée, tout en soulignant son enracinement dans la pratique et soulignant par la même occasion la nécessité d’une lutte antagoniste pour parvenir à un changement durable. Dans un cadre qui repense les frontières de la citoyenneté, l’accent marxiste classique sur la lutte des classes est ainsi élargi pour prendre en compte d’autres formes d’oppression. La libération des femmes joue un rôle central tant dans la réflexion théorique sur la réalité sociale que dans les efforts pratiques entrepris pour changer radicalement cette réalité. Le mouvement affirme que, pour que la lutte sociale soit un succès, il est vital de bien comprendre les liens entre oppressions capitaliste, étatiste et sexiste. En prenant en compte les idées des mouvements de résistance anticoloniaux et anticapitalistes du XXe siècle, la compréhension de la lutte elle-même est donc fondamentalement reformulée.
La jinéologie, un cadre d’analyse féministe radicale que le mouvement kurde développe depuis 2008, tente de transférer dans la société les avancées du mouvement des femmes kurdes. Néologisme dérivé du mot kurde pour femme, jin, la jinéologie critique comment les sciences positivistes ont monopolisé toutes les formes de pouvoir dans les mains des hommes. En tant que paradigme théorique, il se fonde sur les expériences concrètes des femmes kurdes confrontées à l’oppression patriarcale et coloniale. En utilisant cette nouvelle perspective, la jinéologie cherche à développer une méthodologie alternative pour les sciences sociales existantes, qui s’oppose aux systèmes de connaissance androcentriques.
En parallèle, elle exprime aussi une critique puissante du féminisme occidental. Selon Dilar Dirik, universitaire et militante pour la jinéologie, la déconstruction féministe des rôles de genre a énormément contribué à notre compréhension du sexisme. Néanmoins, la jinéologie reste critique face à l’échec du féminisme occidental dans la construction d’une alternative. Elle critique l’échec du féminisme dominant (“mainstream”) à réaliser un changement social plus large, en ayant limité l’ampleur du cadre de l’ordre en place. Le féminisme intersectionnel s’attaque à ces questions, soulignant le fait que les formes d’oppression sont interdépendantes et que le féminisme doit adopter une approche holistique pour s’y attaquer. Pour autant, selon le mouvement kurde, le problème est que ces débats ne quittent jamais les cercles universitaires. La jinéologie se propose comme une méthode pour explorer ces questions de manière collectiviste. En tant que telle, la jinéologie peut être vue comme la pratique vivante qui a émergé des discussions des femmes des quatre coins du Kurdistan.

Necîbe Qeredaxî est journaliste et défenseuse des droits des Kurdes depuis dix-huit ans. Elle est membre fondatrice d’un centre de recherche en jinéologie à Bruxelles, qui ouvrira bientôt ses portes au public. Le but de l’organisation est la promotion de la recherche en sciences humaines et sociales concernant l’émancipation des femmes. Le centre organisera des séminaires et des ateliers, mènera des recherches sur la violence de genre et l’oppression des femmes et cherchera à toucher les mouvements féministes en Belgique et au-delà.
Qu’est-ce que la jinéologie et en faveur de quoi lutte-t-elle ?
Necîbe Qeredaxî : Le terme de jinéologie est composé de deux mots : jin, le mot kurde pour “femme” et de logos, le grec pour “mot” ou “raison”. Il s’agit donc de la science ou de l’étude des femmes. Qu’est-ce que la jinéologie, pour ceux qui en entendent parler pour la première fois? La jinéologie est à la fois un aboutissement et un début. C’est le résultat du progrès dialectique du mouvement des femmes kurdes, ainsi que le début d’une réponse aux contradictions et aux problèmes de la société moderne, de l’économie, de la santé, de l’éducation, de l’écologie, de l’éthique et de l’esthétique. Bien que les sciences sociales aient abordé ces questions, elles restent influencées par l’hégémonie régnante et elles ont déformé les questions posées, notamment sur les relations entre hommes et femmes. La jinéologie propose donc une nouvelle analyse de ces domaines.
Sur quoi basons-nous notre analyse ? Premièrement, sur la dialectique de l’évolution du mouvement des femmes kurdes au sein du mouvement de libération kurde. D’emblée, le mouvement de libération kurde n’ a pas seulement lutté contre les contradictions du nationalisme, mais il a également lutté contre les contradictions au sein même de la société kurde. Il s’est ainsi engagé à la fois dans une lutte nationale et dans une lutte pour l’égalité des sexes. Le mouvement kurde pour la liberté a commencé sa lutte en Mésopotamie, où les femmes constituent un potentiel historique. La jinéologie se concentre sur ce potentiel et sur les réalités historiques qui le sous-tendent. Un deuxième point de référence pour nous, ce sont les réalités du Kurdistan d’aujourd’hui, les réalités d’une société naturelle qui a été détruite et soumise, mais qui est néanmoins toujours vivante.
Qui a développé la jinéologie, et pour quelles raisons ? La jinéologie est un concept qui semble n’être apparu que récemment. À quoi répond-elle ? Quelles étaient les circonstances de son développement ?
Le mouvement féministe kurde est aujourd’hui très important et très avancé sur le plan institutionnel. Il est passé d’un niveau basique d’auto-organisation à l’organisation d’unités militaires et d’un parti des femmes. Maintenant, nous nous trouvons à un moment où le mouvement des femmes est devenu comme un parapluie. Sous ce parapluie, dans les quatre parties du Kurdistan, il y a des centaines d’unités civiles, partisanes et militaires. Maintenant que le mouvement s’est développé, il est nécessaire d’avoir une mentalité de prise de direction commune pour avoir un impact sur la société. Tant que ces développements resteront pris au piège d’un certain nombre d’organisations intellectuelles, d’élite et d’avant-garde, il n’ y aura pas de changement social durable.
Il y a toujours le risque de revenir en arrière. En 2008, le livre Sociology of Freedom, contenant les textes d’Abdullah Öcalan, a été publié en cinq volumes. Dans le troisième volume, Öcalan propose la jinéologie comme science qui peut transformer la mentalité de la société. Parce que même s’il y a certainement du changement, nous devons le rendre durable et efficace au niveau du paradigme sous-jacent. Afin de faire durer les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent, nous ne pouvons nous contenter de réformes.
Öcalan dit que si les progrès que nous avons accomplis ne sont pas soutenus scientifiquement et académiquement, et si les hommes ne se transforment pas eux-mêmes, alors il y a toujours le risque que le pouvoir masculin se rétablisse et opprime le potentiel établi par les femmes. Cela signifie que, pour créer de nouvelles possibilités et un changement social durable, il faut aussi que des transformations de genre se produisent au sein de la société. Suite à cette proposition, un comité d’une trentaine de membres a été créé en 2008 pour discuter de la jinéologie et des moyens de la développer. Depuis lors, des comités de jinéologie ont été créés dans de nombreuses villes du Kurdistan du Nord (Bakûr, le Kurdistan turc, NDT). Quant au Rojava (Kurdistan Ouest, en Syrie, NDT), il s’y trouve un grand nombre d’organisations pour la jinéologie, dont l’académie centrale de jinéologie et plusieurs centres de jinéologie. En Europe, la jinéologie est à l’ordre du jour du mouvement des femmes depuis trois-quatre ans et de nombreuses conférences, séminaires et débats ont été organisés dans différents pays.
Au cours des trois dernières années, nous avons compris qu’il fallait institutionnaliser davantage ce processus. C’est pourquoi, au début de l’année 2016, un groupe de journalistes, d’universitaires, de membres du mouvement des femmes, d’intellectuel.le.s – issu.e.s de milieux divers – s’est réuni et a créé en 2017 le Centre de Jinéologie ici à Bruxelles, où nous voulons collaborer plus étroitement avec les mouvements féministes de toute l’Europe. La plupart d’entre nous sommes bénévoles. Nous ne recevons pas d’argent parce que nous voulons faire de la jinéologie une activité à laquelle tout le monde peut travailler et participer.
Vous avez dit que vous vouliez toucher les mouvements féministes en Europe. Cela m’amène à m’interroger sur la relation entre la jinéologie et le féminisme. En quoi la jinéologie est-elle différente du féminisme ? Et dans quelle mesure s’inspire-t-elle également du féminisme ?
La jinéologie n’est pas une alternative au féminisme. Il faut que cela soit bien clair. Nous ne disons pas, débarrassons-nous du féminisme et mettons la jinéologie à sa place. Nous l’avons dit très clairement et je tiens à le répéter une fois de plus. Certain.e.s ont dit que la jinéologie est du féminisme kurde, mais ce n’est pas le cas, ce n’est pas du féminisme kurde.
Pourquoi ?
Parce que lorsque le mouvement des femmes kurdes a commencé, on a analysé les contradictions de la société kurde et on a commencé à s’y attaquer via la lutte des femmes. Lorsque des recherches sur les mouvements féministes ont été faites, on s’est rendu compte qu’on pouvait prendre certaines parties du féminisme comme héritage. Mais la société kurde et les sociétés du Moyen-Orient ne peuvent être modifiées par le féminisme seul. Nous avons une vision critique du féminisme. Le féminisme n’est pas en mesure de considérer dans une perspective holistique l’ensemble des problèmes d’une société, en particulier au Moyen-Orient. De plus, le féminisme est devenu trop divisé et s’est séparé des réalités sociales. Il s’est limité aux élites.
Ce qui est vrai pour l’Europe n’est pas toujours vrai pour le Moyen-Orient. Les femmes partagent bien sûr certaines choses sur tous les continents, mais nous sommes aussi différentes. Par exemple, dans certains pays d’Europe, les femmes se battent pour le droit à l’avortement, mais au Moyen-Orient, les femmes sont toujours excisées et violées. Par conséquent, les perspectives des mouvements féministes de femmes restent inadéquates vis-à-vis des réalités de nombreux endroits dans le monde.
Mais cela ne signifie pas que nous n’acceptons pas l’héritage du mouvement international des femmes. Nos références en jinéologie s’inspirent de l’héritage du mouvement féministe occidental. Par exemple, le mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, les communes de femmes pendant la révolution en France, la lutte des femmes sous la conduite d’Alexandra Kollontai, la lutte des femmes menée par Rosa Luxemburg en Allemagne, Maria Mies (lien en anglais), une écoféministe contemporaine, ou la lutte des femmes en Amérique latine. Nous considérons tout cela comme faisant partie de notre héritage, mais nous constatons aussi que les mouvements féministes sont très eurocentrés. De plus, ils se sont soumis au pouvoir du système capitaliste et à la mentalité patriarcale.
Beaucoup de féministes ne voient pas les liens dessinant le triangle patriarcat, capitalisme et État-nation. En brisant ce triangle, elles brisent leur ennemi. Ce qui se passe aussi, c’est que certains hommes luttent contre le capitalisme et l’État-nation, mais ils ne voient pas le patriarcat comme une partie du problème. Ou certaines féministes ne voient que le patriarcat comme un problème, mais elles ne voient pas comment cette mentalité est liée à l’État et au capitalisme.
Il y a deux semaines, j’étais à une conférence à Berlin. Quelqu’un de l’association féministe organisatrice de l’événement a fait remarquer : “Qu’est-ce que les événements au Moyen-Orient ont à voir avec nous ? Les femmes portent des armes, ce n’est pas bien. Pour quoi est-ce que vous importez leurs problèmes dans notre pays ?” Ce n’est qu’un exemple. Bien sûr, toutes les Allemandes ne pensent pas comme ça, et toutes les organisations féministes non plus. Mais il y en a beaucoup qui le font.
Lorsque l’Allemagne vend des armes à la Turquie et à l’Arabie saoudite, lorsqu’elle soutient les dictatures au Moyen-Orient, c’est la responsabilité des mouvements féministes de s’y opposer et la jinéologie leur reproche de ne pas l’avoir fait. Ces mouvements ne doivent pas être en contradiction avec les réalités sociales, ils doivent penser globalement. Nous croyons que la jinéologie peut apporter une nouvelle énergie à ces mouvements. Nous pouvons être comme un pont pour construire des relations symbiotiques et créer une plateforme commune, où nous évaluons les critiques du mouvement féministe et où nous travaillons ensemble sur ces choses qui font la force de la jinéologie.
Le mouvement kurde est devenu très populaire récemment en Occident. Surtout dans les médias occidentaux libéraux et de gauche, nous avons vu de nombreuses images de femmes kurdes se battant contre l’EI. Cela a été une grande source de fascination en Occident. Du point de vue de la jinéologie, quelle est votre position sur le rôle des femmes dans la guerre et sur l’autodéfense ? Quelle est votre réponse à la critique selon laquelle les femmes ne devraient pas porter d’armes ?
Je dirais qu’il y a des avantages et des inconvénients à cela. L’avantage est que cela a levé l’embargo qui a longtemps été imposé au mouvement de libération kurde, ainsi que le fait qu’il figure sur la liste des organisations terroristes. Le mouvement a été criminalisé et perçu de façon très négative, mais ce point de vue est maintenant contesté à l’échelle internationale. Le mouvement de libération kurde ne se préoccupe pas seulement de la société kurde, mais aussi des autres ethnies et religions avec lesquelles nous vivons côte à côte, comme les Arabes, les Assyriens, les Syriaques, les Tchétchènes, les Arméniens, les Turkmènes, les Azéris, les Juifs, les Chrétiens, les Chiites… Cet aspect est apparu à la lumière du jour et a créé une image plus positive du mouvement kurde pour la liberté. Ça, c’est d’un côté.
D’un autre côté, il y a l’inconvénient que la force n’est perçue que comme une question d’armes. Par exemple, les femmes des Unités de protection des femmes (YPJ) sont représentées comme de grandes héroïnes pour avoir combattu l’EI avec leurs armes. Mais quelles sont les forces en jeu ? L’autodéfense n’est-elle qu’une question d’armes ? Ou peut-on penser à d’autres formes d’autodéfense ? Une fois que l’EI et l’oppression coloniale seront vaincues, une fois les combats terminés, devrions-nous dire que la lutte de ces femmes a aussi pris fin ? C’est précisément là que commence le vrai questionnement. Pour le mouvement de libération kurde, les armes sont un moyen d’autodéfense, mais l’autodéfense ne passe pas seulement par les armes. En Europe, par exemple, les gens n’ont pas d’armes à la main et ils sont néanmoins attaqués chez eux – les gens se font sauter dans leurs métros. Vous ne pouvez donc pas compter uniquement sur l’État pour vous défendre.
Cela soulève la question de savoir comment la société peut se défendre mentalement et idéologiquement, par le biais de l’organisation et du développement mental. L’une des méthodes les plus importantes par lesquelles une société peut se défendre est le développement du concept de libre coexistence. Nous en avons vu récemment un des exemples les plus intéressants dans le Sinjar (district du nord-ouest de l’Irak, NDT). Par exemple, une femme du Sinjar disait que “encore hier, les arabes sunnites étaient nos invité.e.s à table. Le lendemain, illes sont venu.e.s détruire notre maison et illes ont kidnappé ma fille”. Cela signifie que là-bas, dans cette société, on n’a pas développé la libre coexistence. Comment les arabes sunnites voyaient-illes le Şengal, comment ces gens vivaient-ils ensemble jusque-là ? Nous devons développer le concept de libre coexistence pour répondre à ces questions.
Donc vous dites que cette libre coexistence est un fondement de l’autodéfense ?
Oui, exactement. Les gens se sont isolés les uns des autres, ils n’assument plus de responsabilités morales ou sociales les uns envers les autres. La société a été brisée au nom de l’individualité. Par la jinéologie, nous voulons développer à nouveau la sensibilité et la responsabilité des uns envers les autres.
En ce sens, la lutte armée n’est que le début d’autre chose ?
Oui. Par exemple, seule une petite partie, environ 20 ou 25 %, de l’enseignement dispensé par les unités de protection du peuple (YPG), les YPJ et les Forces démocratiques syriennes (FDS) concerne l’utilisation d’armes. Le reste est un développement de l’idéologie, de l’éducation politique ainsi que de la personnalité. Parce que l’objectif n’est pas seulement d’éliminer certaines zones dominées par l’EI en utilisant les armes, mais aussi d’établir certaines relations sociales.
Par exemple, dans les régions prises en charge par les YPG/YPJ ou par les FDS, les populations locales sont encouragées à s’investir dans l’agriculture et l’élevage. Il y a des régions où, pendant soixante-dix ans, le régime Assad n’a pas laissé les gens planter du blé. Et parmi ces femmes qui portent des armes, beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui impliquées dans des activités en Europe. Il y a donc toujours un potentiel pour autre chose que les armes. Ces personnes peuvent faire partie de la société, elles peuvent former une organisation, s’engager dans des activités civiles, éduquer la société, diriger une académie. En fin de compte, ce qui importe, c’est la transformation au niveau de la mentalité.
Au sein du mouvement kurde, les outils d’analyse les plus importants semblent être le genre et l’identité, c’est-à-dire l’identité kurde et la libération des femmes. Je me demande dans quelle mesure les classes sont-elles encore un outil d’analyse de la lutte sociale ?
Si nous regardons la transformation du mouvement kurde, nous constatons qu’après les années 90 un certain nombre de changements fondamentaux ont eu lieu. Au début, le mouvement kurde menait principalement une lutte de classe, fondée sur des idées marxistes-léninistes. L’aspect principal du changement de paradigme [dans les années 90] réside dans la compréhension de la lutte des classes comme fondée sur la colonisation de l’esprit. Dans le marxisme classique, l’idée c’est que les différences de classe sont la cause de l’oppression et de la lutte. Mais Öcalan dit que, parce que l’oppression se produit dans les esprits, et parce que c’est d’abord et avant tout une oppression des femmes, nous devons d’abord lutter contre cette oppression. Si la caractéristique fondamentale de l’oppression des femmes n’est pas comprise, aucune lutte ne pourra jamais réussir.
Nous pensons que, dans un premier temps, nous devons nous demander comment l’oppression mentale a été imposée. Selon la jinéologie, cette oppression a été imposée de trois manières : premièrement, les femmes ont été opprimées sexuellement et donc objectifiées. Deuxièmement, les femmes sont devenues économiquement opprimées. Et troisièmement, les transformations idéologiques – comme la mythologie et la religion – ont contribué à cette oppression.
Avec l’aide de la jinéologie, et afin de faire les choses différemment, nous cherchons à entrer dans les profondeurs de l’histoire et à chercher le moment où les femmes ont été forcées de disparaître. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le symbole de la jinéologie est un fuseau (batôn en bois permettant d’enrouler du fil à tisser, NDT). Le fuseau est un instrument que les mères ont créé il y a plus de 10 000 ans et qui a survécu jusqu’ à ce jour. Nous suivons le fil du fuseau à travers l’histoire pour étudier comment la résistance des femmes a évolué autour de ce fil symbolique.
Nous pouvons voir que la jinéologie est très étroitement liée à la lutte kurde. Mais quelle est l’importance de la jinéologie pour les femmes ici en Europe ? La jinéologie est-elle seulement quelque chose pour les femmes kurdes ou peut-elle aussi être une source d’inspiration pour les femmes d’autre part ?
La façon dont nous concevons la jinéologie se déroule en deux temps. Le premier a trait à la présentation de ce qu’est la jinéologie et à l’information des gens à ce sujet, et le second à son institutionnalisation. Ce que nos efforts sur le plan international au cours des quatre ou cinq dernières années ont montré, c’est que la jinéologie n’est pas que pour les femmes kurdes. Tous les endroits où nous sommes allées – en Amérique du Sud et du Nord, en Europe, en Australie – à différents débats, conférences et séminaires, nous avons vécu l’expérience d’une grande synergie, de liens forts se mettant en place. Pour nous, cela indique que nous sommes sur la bonne voie.
Nous pensons que le système capitaliste a créé de grandes crises sociales. Cette crise ne concerne pas seulement la société kurde, elle a une influence particulièrement forte en Europe. Par le biais de la jinéologie, nous voulons créer une plateforme de discussion sur les sciences sociales. Nous savons que les sciences sociales actuelles ne sont pas la solution à la crise sociale, mais nous croyons que la jinéologie peut créer de nouveaux courants et de nouvelles discussions au sein des sciences sociales. En particulier, nous voulons créer une plateforme commune de discussion avec les mouvements féministes d’Europe. Nous considérons que les discussions avec les féministes européennes sont très importantes. Nous voulons discuter des questions de genre, ainsi que des problèmes qui émergent aujourd’hui dans le cadre d’une crise sociale. Pourquoi, par exemple, le racisme devient-il de plus en plus fort ? Quelle en est la raison ? Pourquoi la crise économique progresse-t-elle ? Et s’agit-il vraiment d’une crise économique, ou peut-être plutôt d’une crise intellectuelle ?
Nous voulons discuter de ces questions avec d’autres femmes pour trouver une nouvelle façon de penser les questions d’économie, de santé, d’éthique, d’esthétique, de méthode et de violence. Avec les méthodes classiques de production du savoir, par le biais d’une réforme juridique, nous ne pouvons pas mettre un terme à la violence structurelle. Au lieu de cela, nous voulons aller plus loin et nous demander d’où vient la violence et l’oppression de genre, et développer les concepts d’autodéfense, de coexistence, de co-leadership. Nous aimerions discuter de tout cela avec les femmes européennes.
Nous nous sommes interrogé.e.s sur la position de la jinéologie par rapport à la théorie queer, puisque la théorie queer semble en fait reprendre certaines des critiques que vous faites du féminisme occidental classique. Il y a aussi beaucoup de critiques du féminisme de la part des féministes noires ou d’autres femmes non blanches, le disant très centré sur l’Occident. Quelle est votre position vis-à-vis de la théorie queer et des autres critiques du féminisme ?
Nous pensons qu’il y a une crise du système, à laquelle sont soumis tous les membres de la société – y compris celleux qui ont des identités sexuelles et de genre différentes. Le système fonctionne en divisant la société et en gouvernant chaque division différemment. Selon la jinéologie, chaque identité a le droit de s’exprimer et de s’organiser. Nous constatons qu’au sein du système capitaliste, certaines identités sociales, qu’elles soient religieuses, ethniques ou sexuées, parviennent à s’organiser et les autres non. Mais nous pensons aussi qu’il ne devrait pas y avoir de telles divisions au sein de la société. La catégorisation identitaire crée des écarts au sein de la société, que le système exploite facilement pour nous diviser davantage.
Nous pensons que nous devons discuter plus avant de la théorie queer. Je pense qu’en tant que théoriciennes et adeptes de la jinéologie, nous sommes encore au début d’un processus d’apprentissage. Il est clair que pour notre société, la théorie queer est très nouvelle. Mais une fois que nous en aurons discuter davantage, la société y répondra peut-être positivement. Permettez-moi seulement d’ajouter qu’au sein du mouvement de libération kurde, il y avait également des personnes transgenres, ce qui était quelque chose de très normal – cela n’ a jamais été une raison de refuser l’adhésion au mouvement.
De fait, nous pouvons constater ce dont vous parlez lorsque nous regardons comment la droite européenne instrumentalise les droits des homosexuel.le.s, en utilisant une rhétorique queer ou féministe, même s’illes ne sont pas vraiment féministes. Tout particulièrement, la droite a très bien réussi à instrumentaliser les droits des homosexuel.le.s et des femmes comme moyen d’exclure les hommes noirs et musulmans. Nous l’avons vu très clairement en Allemagne après les événements du Nouvel An à Cologne, il y a deux ans.
Au Moyen-Orient, c’est la même chose avec les mouvements islamiques féministes. Ils ont interdit toutes les transformations sociales au sein des communautés faisant référence à l’islam et ils ont utilisé les arguments islamiques pour opprimer la société.
À cet égard, comment voyez-vous le rôle de la religion ? Et qu’en est-il des hommes ou des femmes qui sont religieux.ses – y a-t-il une place pour elleux dans la jinéologie?
Nous ne rejetons pas entièrement la religion, et nous ne la considérons pas non plus comme quelque chose de vrai que nous défendons. Nous abordons plutôt la religion d’un point de vue sociologique. Comment la religion est-elle née, comment est-elle devenue une institutionnalisation de la mythologie ? Pour nous, à sa base même, la religion est une mythologie qui s’est institutionnalisée. Mais en même temps, elle peut aussi être une méthode de résistance.
Souvent, ceux qui détiennent le pouvoir utilisent la religion comme moyen de légitimer leur pouvoir. Ils s’en servent pour établir leurs lois sur ses bases, pour donner forme à la société, pour créer un système dominant qui entre même dans vos rêves. Ils interviennent dans tous les aspects de votre vie. Nous savons que les deux étapes, de la mythologie puis de la religion, ont entraîné d’immenses revers pour les femmes. Par exemple, avec l’idée que la femme a été créée à partir du front de Zeus, ou qu’elle a été créée à partir de la côte de l’homme.
Nous pensons donc qu’il est important de faire des recherches sur les transformations du stade de l’animisme à celui du chamanisme, ainsi que de la mythologie à la religion. Selon la jinéologie, l’animisme et le chamanisme sont en fait des formes de religion. L’animisme est une croyance basée sur la force de la nature, tandis que le chamanisme est basé sur le patriarcat. La figure du chaman réunit la force matérielle et la force morale du chasseur et, avec la figure du commandant militaire, elle crée un triangle de religion, de puissance et d’autorité militaire, qui est devenu le noyau de l’hégémonie sur les femmes par la colonisation de leur travail et de leurs esprits.
En même temps, nous ne nions pas la religion. Il y a aussi des éléments positifs au sein de la religion, des éléments moraux et culturels que la religion défend. De plus, les mouvements religieux ont également résisté à l’hégémonie, en particulier les religions qui n’ont pas de dieu abstrait, comme le yézidisme, l’alévisme ou le zoroastrisme, qui sont centrées sur l’humain.
Au sein du féminisme, l’idée que le genre soit construit socialement a suscité beaucoup de scepticisme à l’égard de la notion de nature ou d’essence féminine. Quelle est votre position sur la notion de nature féminine ?
Ce fut une discussion très critique lors de notre camp à Cologne cet été. Je crois que les mouvements féministes féminins ne l’ont pas assez exploré non plus. Les arguments avancés jusqu’à présent ne vont pas tous dans le même sens. L’existence humaine est une existence à la fois biologique et sociale. Les sciences actuelles ont nié des vérités historiques très importantes. Par exemple, certain.e.s disent que la nature des femmes n’existe pas. Mais la biologie a prouvé qu’au début, il n’ y avait que le chromosome XX, pas celui de XY. Qu’est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que l’existence biologique des femmes peut aussi englober celle des hommes, tandis que l’inverse n’est pas vrai.
En tant qu’adeptes de la jinéologie, nous ne sommes pas d’accord avec l’idée que la nature de la femme n’existe pas, mais nous voulons approfondir cette question. Nous pensons que les sciences sociales ont joué un rôle dans le déni de la vérité sur les femmes. Une fois que vous cessez de nier la vérité sur les femmes, vous ouvrez la question de savoir comment cette vérité a été déformée et opprimée. Si vous reconnaissez qu’il y avait autrefois une vérité sur les femmes, mais que les aspects biologiques et sociologiques de cette vérité ont été transformés, alors nous pouvons discuter. Mais si vous dites qu’il n’ y a pas de nature féminine, et que c’est tout, alors c’est aussi une forme de dogmatisme sans grande différence avec le dogmatisme de la religion ou de la mythologie.
Dans le système matriarcal, la nature des femmes a ouvert la voie à la socialisation. Quelles étaient les relations de parenté dans cette société ? Par exemple, pourquoi les relations sexuelles entre frères et sœurs sont-elles interdites ? Comment ces tabous positifs ont-ils été créés ? Ce sont des produits de la nature des femmes, de la raison analytique et émotionnelle des femmes. Si ce n’est pas ça la nature des femmes, alors qu’est-ce que la nature des femmes ?
Dans beaucoup de luttes nationales, nous constatons que même si les luttes des femmes et la lutte nationale se déroulent en parallèle, c’est souvent la lutte politique qui finit par supplanter la lutte des femmes. Considérez-vous qu’il y a un risque que la lutte des femmes kurdes devienne secondaire par rapport au mouvement politique ?
Une lutte nationale est toujours pleine de risques. Au Moyen-Orient, une lutte nationale seule peut devenir très dangereuse si elle n’est pas accompagnée d’une lutte de genre. En termes de terminologie, le mouvement de libération kurde ne prétend plus mener une lutte nationale, mais une lutte pour une nation démocratique. Parce que si la nation n’est pas démocratisée, elle risque toujours d’être utilisée contre une autre nation. On le voit au Kurdistan du Sud [la région kurde d’Irak] : là-bas, il y a maintenant une nation autoritaire, comme elle n’a pas été démocratisée, elle reste un risque pour sa propre société.
Quelle est donc la différence entre une nation et une nation démocratique ? Le but des luttes nationales habituelles est la création d’un État. Elles cherchent à renverser un État et à ériger un nouvel État-nation à sa place, fondé sur l’idée d’une nation, d’une langue, d’une histoire, d’un drapeau, d’une culture. Cependant, l’objectif du mouvement de libération kurde n’est pas cela. Le but de la nation démocratique est que la société se gouverne en autonomie démocratique. La gouvernance de la société est remplacée par l’autogestion de la société. Personne ici ne vient de l’extérieur pour gouverner la société, mais la société se gouverne elle-même. En termes d’institutions, cela signifie qu’il y a des conseils et des communes, qui sont partagés avec d’autres nations. Le système de codirection, par exemple, inclut les Arabes, les Turkmènes, les Arménien.ne.s, etc.
L’idée fondatrice n’est donc pas celle d’une seule nation. Au Rojava, c’est ce système qui a le plus progressé. Là-bas, différentes nations s’organisent au sein du cadre du mouvement de libération kurde. Elles ne s’organisent pas sous le mouvement de libération kurde, mais elles sont engagées dans cette lutte en parallèle et avec le mouvement kurde. Ce n’est donc pas que les Kurdes viennent organiser les Arabes ou les Turkmènes. Au lieu de cela, les Assyrien.ne.s ont leurs propres unités armées (Sutoro) ou encore, par exemple, le conseil militaire de Manbij est composé de Kurdes et d’Arabes. Donc, sur tous les fronts, nous constatons que la lutte nationale n’est plus la lutte d’une seule nation. C’est une lutte démocratique.
Dans l’un de ses discours, Öcalan dit qu’il a créé l’expression Jin, jiyan, azadî – femme, vie, liberté – comme une expression enchanteresse. Contre quoi est-ce que Jin, jiyan, azadî est dirigée ? Elle est dirigée contre la formule de la mort, du sexe et de l’esclavage. La mort signifie ici la mort à la fois physique et mentale. Et l’esclavage se réfère à la façon dont toute la société est asservie, représentée par la figure de la femme. Par conséquent, cette formule ne s’adresse pas seulement aux femmes kurdes, mais aussi aux femmes d’autres sociétés. Cela signifie que la lutte pour une nation démocratique et la lutte pour l’égalité des genres se mènent toujours ensemble.
Brecht Neven, Marlene Schäfers
Publié le 25 novembre 2017, en anglais sur ROAR Mag dans le rubrique “Égalité et autonomisation”
Brecht Neven
Brecht Neven est un jeune diplômé en sciences politiques de l’Université de Gand (Belgique). Il a écrit sa thèse sur le paradigme idéologique du mouvement kurde, en faisant une comparaison avec le mouvement anarchiste pendant la guerre civile espagnole. Il suit actuellement une maîtrise en journalisme à la Vrije Universiteit Brussel.
Marlene Schäfers
Marlene Schäfers est une anthropologue sociale et actuellement FWO [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie Fellow du Middle East and North Africa Research Group de l’Université de Gand (Belgique).