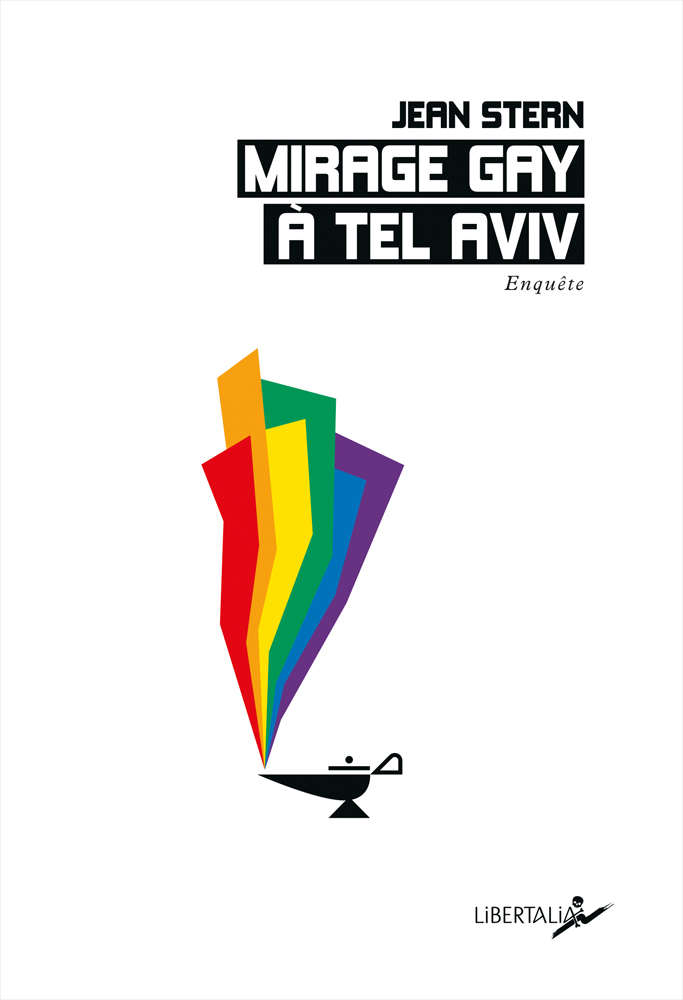Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Zones éditions, 2017.
Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Zones éditions, 2017.
Dans le prologue de Se défendre, Elsa Dorlin revient sur le lynchage de Rodney King, chauffeur de taxi noir, par la police de Los Angeles. C’était en mars 1991 et, comme c’est devenu la norme aujourd’hui, la scène fut entièrement filmée par un témoin qui, « ce soir-là […] captur[a] ce qui s’apparente à une archive du temps présent de la domination. » La vidéo fut diffusée par les chaînes de télévision du monde entier. Un an plus tard, quatre policiers (ils étaient plus nombreux à avoir pris part au lynchage, mais seuls ces quatre-là avaient été inculpés) furent « blanchis » (c’est le cas de le le dire) par un jury populaire. Leur acquittement provoqua une certaine émotion dans les quartiers « susceptibles » de la ville des anges : afin de mettre fin aux émeutes qui s’ensuivirent, l’armée et la police tuèrent 53 personnes et en blessèrent 2 000… Si l’on croit savoir pourquoi une agression caractérisée et parfaitement documentée – la vidéo est toujours visible sur le net, ici par exemple – donna lieu à ce verdict pour le moins clément (grâce au racisme toujours à l’œuvre aux Etats-Unis), reste à comprendre comment, dans la pratique, il fut obtenu. Certes, aucun Africain-Américain ne faisait partie du jury – ils avaient été récusés par les avocats de la police. Tout de même, lorsque l’on voit les images, on se dit qu’il n’est pas possible d’innocenter les flics. Leurs avocats ont pourtant réussi le tour de force de présenter Rodney King comme l’agresseur ! Selon eux, les cops se sont sentis en danger face à un « colosse » qui tentait d’esquiver leurs coups. « Dans la salle d’audience, écrit Elsa Dorlin, la vidéo, visionnée par les jurés et commentée par les avocats des forces de l’ordre, est regardée comme une scène de légitime défense témoignant de la “vulnérabilité” des policiers. » Cette interprétation aberrante pour quiconque a vu les images de ce lynchage, car c’est bien ce qu’elles montrent, ne peut s’expliquer, selon Judith Butler, citée par Elsa Dorlin, que par le « cadre d’intelligibilité de perceptions qui ne sont jamais immédiates ». Dans un texte écrit peu après le verdict, Butler soutient que « la vidéo ne doit pas être appréhendée comme une donnée brute, matière à interprétations, mais comme la manifestation d’un “champ de visibilité racialement saturé” ». En d’autres termes, les policiers et les membres du jury ont vu ce qu’ils voulaient/pouvaient voir. Aujourd’hui comme hier en Amérique, l’agresseur est forcément le Noir, contre lequel il est légitime de se défendre. Lorsque celui-ci se mêle de se protéger, voire de se défendre à son tour, il devient gibier à abattre – voir, entre autres, l’histoire du Black Panther Party for Self-Defense.
Dans ce livre, Elsa Dorlin « retrace une généalogie de l’autodéfense politique », nous dit le texte de couverture. Il s’agit d’une double généalogie, ou de la généalogie de deux mouvements antagonistes : celle de la « légitime défense », autrement dit celle de la défense agressive des privilèges blanc et mâle, et celle de l’autodéfense des subalternes, « des résistances esclaves au ju-jitsu des suffragistes, de l’insurrection du ghetto de Varsovie aux Black Panthers ou aux patrouilles queer ». Dorlin commence par montrer comment l’avènement de la Modernité a reposé, entre autres conditions, sur « la fabrique des corps désarmés ». Mais pas n’importe lesquels : par exemple, le Code noir français (1685) défend « aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons », sous peine de fouet. Non seulement les esclaves ne devaient pas être armés, mais était prohibé tout ce qui pourrait leur donner l’occasion de « se préparer, de s’exercer à la révolte ». Elsa Dorlin cite ainsi Elijah Green, ancien esclave né en 1843 en Louisiane, lequel « rapporte qu’il était strictement interdit à un Noir d’être en possession d’un crayon ou d’un stylo sous peine d’être condamné pour tentative de meurtre et pendu ». (C’est moi qui souligne.) Par contre, « dans la plupart des contextes coloniaux et impériaux, le droit de porter et d’user d’armes est systématiquement octroyé aux colons. »
Cependant les subalternes s’organisent – ainsi, dans tous les contextes esclavagistes sont nées des pratiques clandestines d’autodéfense esclave, souvent déguisées en arts « inoffensifs », dont certains sont désormais bien connus en territoires métropolitains, et pratiqués pour leur aspect festif plutôt que martial, telle la capoeira brésilienne. Durant la Révolution française, des femmes réclament le droit de porter les armes et de former des « bataillons d’Amazones » en défense de la Révolution. Dans l’Angleterre du début du siècle passé, les suffragistes du Womens’s Social and Political Union pratique le ju-jitsu tout récemment importé du Japon et adapté aux besoins du combat de rue et de la protection des militantes féministes. « L’autodéfense des militantes du WSPU a été, précise Elsa Dorlin, non pas tant une ressource choisie dans un répertoire d’actions pour défendre leur cause – à savoir le droit de vote –, mais bien ce qui leur a permis de lutter collectivement par elles-mêmes et pour elles-mêmes, empêchant toute instrumentalisation nationaliste de leur cause. L’autodéfense n’est donc pas un moyen en vue d’une fin – acquérir un statut et une reconnaissance politiques –, elle politise des corps, sans médiation, sans délégation, sans représentation. » Je souligne ces mots qui me paraissent très importants en ce qu’ils permettent aussi bien, me semble-t-il, de comprendre ce qui se jouait dans les têtes de cortège du printemps 2016 à Paris et autres lieux…
Elsa Dorlin distingue ainsi « légitime défense » – de l’ordre raciste par le Klu Klux Klan ou les Dupont-la-Joie français flinguant des Arabes au petit bonheur dans les années 1970, tâche plus souvent déléguée à la police par la suite – et autodéfense populaire. Elle pointe cependant les dérives possibles de cette dernière, comme celle qui aboutit à la disparition du Black Panther Party, lequel, non seulement fut décimé par les forces de répression, mais aussi céda à une fascination machiste des armes et de l’uniforme qui le coupa de ce qu’il aurait dû être, ou rester : une force révolutionnaire.
Autre dérive, celle d’une partie du mouvement gay américain qui a contribué, afin d’aménager des zones safe pour le homosexuels, à inventer ce que nous connaissons aujourd’hui en France comme les « Voisins vigilants », soit une obsession sécuritaire que le (néo)libéralisme ambiant a très bien su diriger contre les pauvres, les marginaux, les délinquants, les gens pas comme il faut.
Le livre se termine pourtant sur une note plus optimiste avec un chapitre intitulé « Répliquer » construit autour d’un roman anglais du début des années 1990, Dirty Week-end, dont voici le résumé donné en quatrième de couverture : « Un beau jour, Bella en eut marre, marre de toujours être la victime, marre de toujours avoir peur, marre des désirs des mecs… Et elle se mit à les tuer. D’abord ce voisin vicieux qui la persécutait, puis un autre, rencontré par hasard, et qui aurait bien aimé la plier à ses caprices. Et cela lui a fait tant de bien, cela l’a tant soulagée, qu’elle se demande pourquoi elle a attendu si longtemps. Et demande pour les femmes le droit à la violence aveugle. » Au cours de ce dirty week-end, tous ceux que Bella va rencontrer y passeront à leur tour. « Les deux jours de Bella, commente Elsa Dorlin, figurent la temporalité d’un stage d’autodéfense féministe, avec sa pratique accélérée, son partage d’expériences, ses prises de conscience et ses recommandations. Bella n’a pas appris à se battre, elle a désappris à ne pas se battre. En passant à une stratégie d’autodéfense féministe, il ne sera donc jamais question de distiller la réalité pour en extraire l’efficace d’un geste (immobiliser, blesser, tuer…) mais, au contraire, de s’enfoncer dans la trame de la réalité sociale de la violence pour y entraîner un corps qui est déjà traversé par la violence, pour déployer un muscle familiarisé à la violence mais qui n’a fondamentalement jamais été éduqué et socialisé à s’entraîner à la violence, à l’agir. »
Elsa Dorlin tire d’autres leçons de ce livre d’Helen Zahavi. Tout d’abord, nous dit-elle, il « offre la possibilité de problématiser ce que nous appellerons un dirty care – un care négatif. » Selon les visions essentialistes, les femmes sont réputées attentives, prévenantes, ce qui explique leur disposition à prendre soin des autres et donc aux professions du care. Le care négatif, nous dit Elsa Dorlin, c’est aussi l’attention portée aux autres, mais pas afin d’en prendre soin : il s’agit d’échapper au harcèlement, au viol, à la violence quotidienne exercée par les hommes sur les femmes. C’est l’attention de la proie par rapport au prédateur. « À partir de cette idée d’attention qui caractérise le dirty care, il est possible de dégager deux éléments majeurs », poursuit Elsa Dorlin. Tout d’abord, ce mode d’attention à l’autre définit un mode de connaissance dans lequel l’objet à connaître prend une importance démesurée. « L’objet devient le centre du monde que le sujet appréhende depuis nulle part. » Dans ce rapport (comme dans tout rapport de domination), c’est l’objet (le chasseur) qui domine le sujet (la proie en tant qu’elle exerce ses capacités cognitives), car c’est lui qui définit les coordonnées de la réalité objective, « c’est son point de vue qui donne le la du réel », réel dont certains auteurs, cités en note par Elsa Dorlin, rappellent que l’étymologie anglaise et espagnole le rapportent « à des expressions qui renvoient à “royal” ou qui sont relatives au roi ». Ainsi, « la propriété de ce qui est réel est ce qui est royal, au roi. Ce qui est réel est ce qui est visible par le roi ». « Autrement dit, cet effort permanent pour connaître le mieux possible autrui dans le but de tenter de se défendre de ce qu’il peut nous faire, est une technologie de pouvoir qui se traduit par la production d’une ignorance non pas de nous-même mais de notre puissance d’agir qui nous devient étrangère, aliénée. » Les dominé·e·s développent ainsi « une connaissance sur les dominant·e·s qui constitue une archive de leur toute-puissance phénoménale et idéologique ». L’autre effet de ce care négatif concerne l’« objet-roi ». Il a déjà été désigné par le concept d’agnotologie, qui est l’étude de la production de l’ignorance. Contrairement aux proies qui doivent en savoir le plus possible sur leurs prédateurs afin d’espérer leur échapper, ces derniers n’ont aucun besoin de connaître mieux leurs proies : « Ignorant·e·s, les dominant·e·s sont engagé·e·s dans des postures cognitives qui leur épargnent à proprement parler de “voir” les autres, de s’en soucier, de les prendre en compte, de les connaître, de les considérer. »
Ouvert sur l’affaire Rodney King, le livre se referme sur le meurtre de Trayvon Martin : le 26 février 2012, George Zimmerman, un bon citoyen américain engagé dans un programme de « voisins vigilants », abat cet ado africain-américain dans un quartier blanc de la ville de Sanford en Floride. Trayvon avait le tort d’être noir et de porter un sweat shirt à capuche, ce qui a semble-t-il suffi à mettre son assassin en position de légitime défense, définie en Floride comme le fait d’agir « pour se protéger si [une personne] ressent un sentiment de peur raisonnable l’incitant à croire qu’elle sera tuée ou gravement blessée ». Un an et demi après les faits, Zimmerman sera acquitté malgré le fait qu’aucune preuve attestant une situation de légitime défense n’ait été produite par ses avocats. « George Zimmerman est un vigilant de l’État racial. Trayvon Martin était sans défense face à la menace d’être, en tant que jeune homme africain-américain, une proie abattable au nom de la légitime défense. » C’est la peur raisonnable ressentie par son assassin qui légalise le meurtre de Trayvon. « La peur comme projection renvoie ainsi à un monde ou le possible se confond tout entier avec l’insécurité, elle détermine désormais le devenir assassin de tout “bon citoyen”. Elle est l’arme d’un assujettissement émotionnel inédit des corps mais aussi d’un gouvernement musculaire d’individus sous tension, de vies sur la défensive. »
C’est ce qu’Elsa Dorlin a cherché – avec succès, à mon avis – à nous faire toucher du doigt tout au long de ce livre excellent dans lequel elle utilise « [s]a propre histoire, [s]on expérience corporelle » pour « arpenter une histoire constellaire de l’autodéfense ». Sa culture théorique et politique, précise-t-elle dans le prologue, lui « a laissé en héritage l’idée fondatrice selon laquelle les rapports de pouvoir ne peuvent jamais […] complètement se rabattre in situ sur des face-à-face déjà collectifs, mais touchent à des expériences vécues de la domination dans l’intimité d’une chambre à coucher, au détour d’une bouche de métro, derrière la tranquillité apparente d’une réunion de famille… » On reconnaît là l’un des apports fondamentaux du féminisme, qui a montré que l’intime, le « privé » sont aussi politiques. Elsa Dorlin entend ainsi « travailler non pas à l’échelle des sujets politiques constitués, mais bien à celle de la politisation des subjectivités ». Et cela passe évidemment par les corps, par les muscles : « Au jour le jour, que fait la violence à nos vies, à nos corps, à nos muscles ? Et eux, à leur tour, que peuvent-ils à la fois faire et ne pas faire dans et par la violence ? » Ici réside l’un des principaux intérêts du livre, à mes yeux : loin des sempiternels débats autour de la violence et de la non-violence (lesquels, me semble-t-il, ne servent la plupart du temps qu’à renforcer les rapports de domination), il envisage les différentes pratiques violentes de façon très concrète, en ce qu’elles servent, ou non, les intérêts des un·e·s et des autres et en ce qu’elles produisent comme effets tangibles sur les corps comme sur les organisations politiques et sociales.