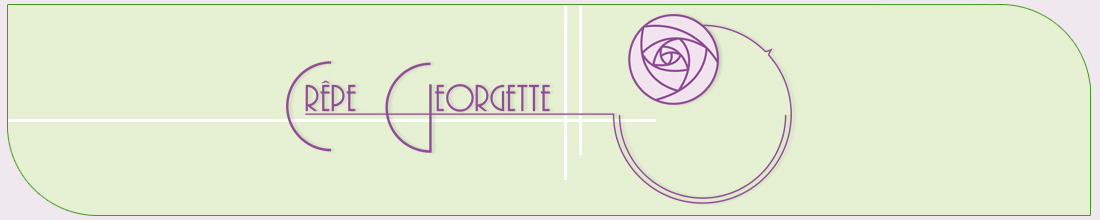Trouvé sur le net (l’original est ici) parmi beaucoup d’autres…
La stratégie du tri
Au plus loin, la rue
Entre deux, au travail et au lycée
Mais il y a bien d’autres situations qui ne rentrent pas complètement dans ce cadre, voire pas du tout. Et plus elles s’en éloignent, plus il devient difficile de les évoquer, de se les représenter.
En-dessous de cette première strate de situations que je peux relater sans problème, il y en a une seconde, déjà un peu plus délicate, qui concerne les situations de harcèlement vécues dans des lycées : l’une en tant que salariée, l’autre en tant qu’élève. Dans les deux cas, il s’agissait d’hommes adultes, un proviseur et un prof. Ces deux situations étaient plus diluées dans le temps, plus sournoises aussi, et caractérisées par un déni massif de l’entourage professionnel (infirmière scolaire, direction, CPE, Rectorat) qui pourtant savait, sans aucun doute possible (plusieurs plaintes avaient été prononcées).
Ces deux situations étaient plus difficiles à dénoncer, parce qu’il n’y a pas eu envers moi d’actes, pas d’agression physique, pas d’insultes : il s’agissait de propos malveillants, de regards déplacés, de manipulations, de remarques sur le physique, de l’instauration d’un climat hostile… C’était, par exemple, de la part du proviseur, le fait de venir s’installer dans mon bureau en l’absence de ma collègue (alors qu’il avait un bureau à lui où il était sensé travailler) et de mettre de la musique (sans me demander mon avis bien sûr), en l’occurrence uniquement des chansons contenant des propos sexuellement explicites. Ceci s’inscrivant dans un comportement quotidien, récurrent : une accumulation de « petites » choses qui font se sentir vulnérable.
Dans les deux cas, j’ai alerté et cherché de l’aide, pas tant pour moi-même que pour des collègues qui m’avaient rapporté des situations d’agressions sexuelles de la part de ces hommes : dans les deux cas, j’ai été ridiculisée et confrontée à la minimisation et la dénégation. Je précise qu’à chaque fois, les personnes vers qui je me suis tournée étaient des femmes. Et je crois que leurs réactions ont été presque plus difficiles à encaisser pour moi que le comportement de ces harceleurs.
Dans ces deux situations de harcèlement caractérisé, qui concernaient plusieurs victimes, et se perpétuaient dans le temps, je me suis confrontée aussi à l’image du lycée comme un lieu nécessairement sain et sécure, un lieu d’apprentissage et de savoir dont la violence serait par définition exclue. Un lieu où l’on pouvait, en tout cas, être protégé-e en cas de problème, à partir du moment où ce problème était signalé.
Cette seconde « strate » m’a donc posé plus de difficulté, bien que ces deux situations aient eu en elles-mêmes moins de conséquences sur moi que les agressions dans la rue : ce qui en a eu, c’est le constat que se plaindre n’était pas forcément efficace, et que la solidarité n’était pas du tout évidente, y compris entre femmes. Le mépris affiché par la gestionnaire du rectorat et l’infirmière scolaire est resté gravé dans ma mémoire : mais qu’en faire ?
Ces deux hommes sont restés à leur poste, et ont continué à nuire. Contrairement aux situations de la 1ere « strate », celles-ci m’ont confrontée à la culpabilité et à une forme de désarroi : n’aurais-je pas du aller plus loin dans mes dénonciations, insister, n’avaisje pas une responsabilité envers les autres personnes déjà victimes ou qui pouvaient le devenir ?
J’ai travaillé successivement dans 6 établissements, avec 6 proviseurs ou principaux différents : 4 sur 6 avaient des comportements de harcèlement (moral uniquement pour la plupart) envers leurs collègues directs (intendant-e, proviseur adjoint, secrétaire…). La violence entre élèves était palpable et quotidienne dans ces établissements. En fait, la violence en général était palpable dans ces établissements, à tous les niveaux, entre adultes, entre enfants, entre adultes et enfants : des atmosphères particulièrement pénibles.
Plus près, les agressions entre pair-es, au collège et entre ami-es
L’idée que des enfants ou de jeunes adolescent-e-s puissent s’agresser sexuellement entre eux heurte en général nos représentations.
Je pense que ma grande difficulté à évoquer ces situations tient aussi au fait qu’elles impliquaient des personnes plus proches affectivement : des élèves de ma classe, qui est restée la même du CE1 à la 3ème. Certains de nos parents étaient amis. Nous allions parfois les un-e-s chez les autres, nous nous voyions en-dehors de l’école.
Il est représentatif que pendant très longtemps, la seule situation dont je me sois souvenue était la suivante : un garçon d’une autre classe, en 5ème-4ème, qui me suivait aux toilettes, m’attendait devant la porte, essayait de me toucher (ce qu’il faisait avec d’autres filles). Ce garçon, je le connaissais à peine (je ne me rappelle pas son prénom), il n’évoluait pas dans mon cercle de connaissances, et en-dehors de ces rares épisodes je n’ai eu aucun contact avec lui.
Mais il y a eu d’autres situations que j’ai refoulées pendant très longtemps :
• l’une impliquant un garçon faisant partie de mes « amis », qui me poursuivait de ses ardeurs malgré mes refus répétés, et est allé jusqu’à me montrer son sexe (pensant sûrement que ça me ferait changer d’avis…!) ;
• l’autre, le harcèlement subi par un groupe de filles, que j’ai mis des années à qualifier de harcèlement sexuel, alors que c’en était : et pas le moins acharné. Insultes, images pornographiques, « petits mots » transmis pendant les cours me mettant en scène dans des situations sexuelles, etc.
Comment dénoncer de tels faits commis par des filles de 13 à 15 ans ?
Voilà une situation à laquelle on ne m’avait pas du tout préparée.
Pourtant le comportement de ces filles a eu sur moi un impact bien plus grave que celui des deux garçons cités précédemment. Parce que plus haineux, plus durable, avec une intention marquée d’humilier. Et parce que ce n’était pas pour moi représentable d’être agressée sexuellement par des filles de mon âge, et qu’il était inimaginable d’en parler à qui que ce soit. Ce n’était pas des filles « masculines », ni considérées comme rebelles, agressives : des filles de familles plutôt aisées, féminines voire très féminines, ne posant aucun problème aux adultes ni à l’institution scolaire.
Je ne suis pas la seule, les situations de harcèlement et d’agressions sexuelles entre filles à l’adolescence sont certainement plus fréquentes qu’on ne le croit. En y repensant, je me confronte à cette interrogation : où ont-elles appris cette violence ? Qu’ont-elles reproduit ? Et je m’aperçois que j’ai plus de difficulté à me poser la question concernant les garçons et les hommes, comme s’il était plus « naturel » ou « attendu » qu’ils soient violents.
Beaucoup plus près : la violence des adultes envers les enfants, les proches, la famille
Une partie de l’explication se situe peut-être dans une autre situation, plus ancienne, et plus difficile encore à admettre : la prof de sport en CE1 qui fait des remarques humiliantes sur le physique des enfants. Qui fait des « plaisanteries » ambiguës lorsqu’elle nous fait faire de la lutte, ou lorsqu’on va à la piscine. Elle me met systématiquement en binôme avec un petit garçon qui fait le même poids et la même taille que moi (nous sommes les plus petits et les plus menus), et elle s’amuse beaucoup à se moquer de nous, à suggérer des attitudes sexuelles – ce que, à 7 ans, nous ne sommes pas tout à fait en mesure de comprendre, et que nous saisissons pourtant.
Tout le monde rit, j’ai le souvenir aigü de l’humiliation que je ressentais, je me souviens du sentiment d’intrusion que provoquaient ses remarques sur mon corps. Je n’ai jamais oublié cet épisode, bien que je l’ai longtemps enfoui.
Malgré tout, là aussi, j’ai mis très longtemps à admettre le caractère sexuel de ses propos et de son attitude, le fait que ce comportement rentrait dans le cadre du harcèlement. Encore aujourd’hui, j’ai du mal à intégrer qu’une femme adulte puisse humilier sexuellement des enfants de 7 ans, mais je sais d’expérience pourtant que c’est possible.
La violence sexuelle des adultes envers les enfants des deux sexes est aussi répandue que taboue…
Evoquer le harcèlement et les agressions qui se produisent dans les familles, dans les cercles d’ami-e-s reste particulièrement difficile.
Dénoncer une personne proche, avec laquelle on a des liens affectifs, est une épreuve qui est souvent risquée, et peut s’avérer insurmontable.
Admettre également la violence exercée par les femmes, en particulier par les femmes envers d’autres femmes, que ce soient dans un couple, dans une famille, dans le cadre d’une relation éducative, vient heurter nos représentations encore très ancrées d’une supposée « non-violence » féminine naturelle, et des relations forcément protectrices des adultes envers les enfants dont ils ont la responsabilité.
Visibiliser la violence sexuelle des hommes entre eux, sans doute beaucoup plus répandue qu’on ne le croit – je connais plusieurs personnes de mon entourage plus ou moins proches qui l’ont subie.
Toutes ces situations se situent, je crois, au centre du cercle, et il nous faudra encore du temps pour pouvoir les aborder et les affronter, dans une perspective féministe, sans craindre de minimiser la domination masculine et les violences faites aux femmes. Parce que ça ne s’oppose pas.
De la réalité complexe des violences sexuelles
En listant toutes ces situations, j’ai compris que la violence sexuelle, si elle s’inscrit dans la domination masculine, ne se limite pas au genre/sexe.
La violence sexuelle n’est pas tant une question de sexualité que de pouvoir : cela peut arriver dans toute situation où il y a rapport de domination. Entre un-e adulte et un-e mineur-e, entre un-e parent-e et un-e enfant, entre un groupe et un individu fragilisé/dominé, etc.
Plusieurs types d’oppressions peuvent être en jeu, qui sont toutes liées : homophobie, transphobie, domination adulte, racisme, validisme, etc… Il ne s’agit pas de désir ou de pulsion sexuelle, mais de l’expression et de l’exercice d’un pouvoir sur l’autre, qui vise à le soumettre.
A ce titre, l’éducation sexuelle n’est pas une solution suffisante : il faut travailler sur les rapports de pouvoir et de domination.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, malgré mon féminisme, mon engagement sur ces sujets, mes prises de positions, je continuais à minimiser, à masquer, à me protéger de cette réalité.
Je ne prétends pas avoir épuisé toutes les situations que j’ai rencontrées dans ma vie : depuis le début de ce mouvement #MeToo, et l’écriture de cet article, des souvenirs me reviennent régulièrement en mémoire. J’ai l’impression que ça n’a pas de fin, et c’est effrayant.
Cette multiplication de témoignages nous place toutes et tous face à une réalité très éprouvante psychiquement : admettre que les situations de violence sexuelle jalonnent nos existences depuis des années, c’est faire face à une image de soi et du monde qu’on préfèrerait ignorer. Et pourtant, c’est une première étape essentielle pour que demain ces situations ne se reproduisent plus.