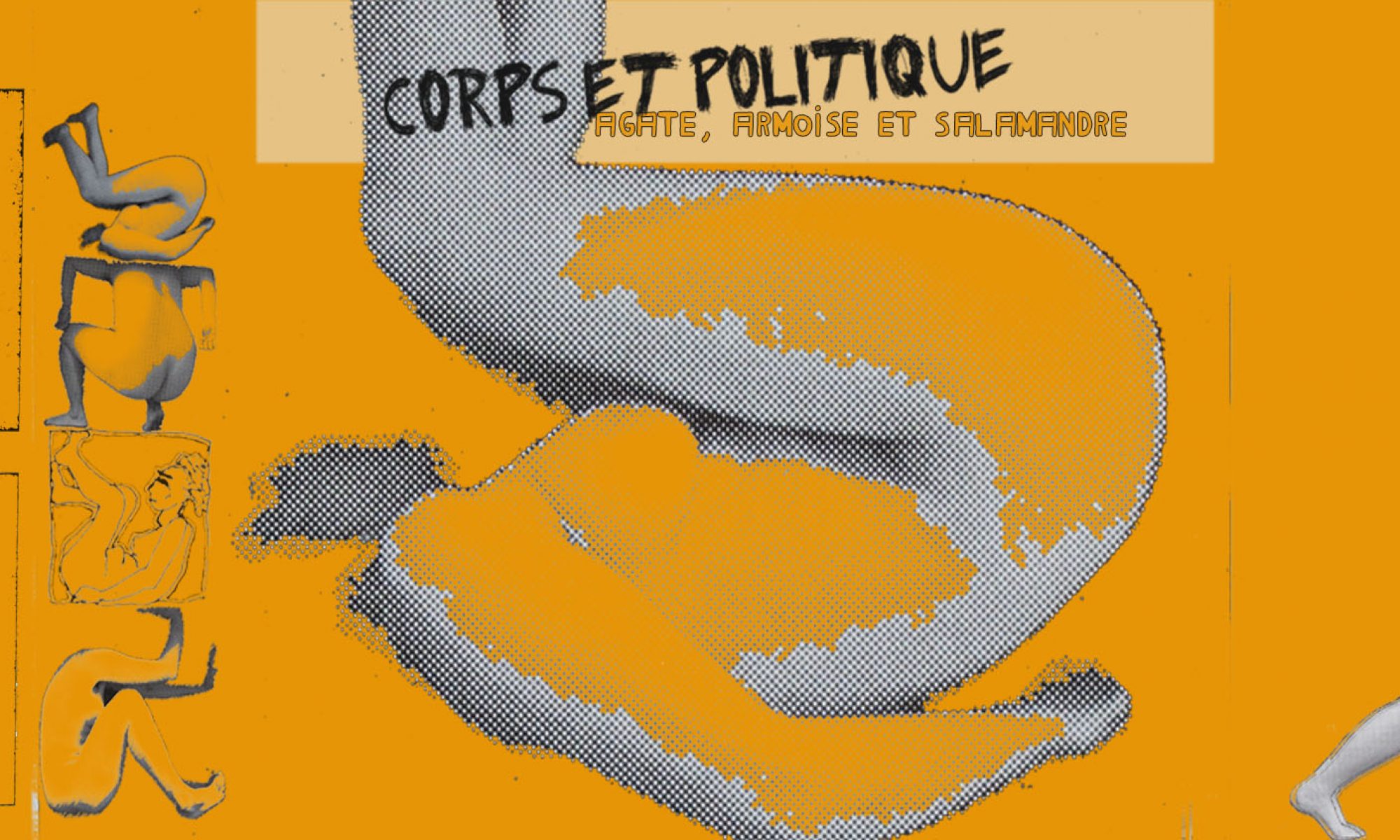N’allez pas voir le film Nos femmes, allez plutôt passer quelques minutes sur ce site:
Poils&Capitons – « Nos Femmes », la grosse poilade sur les violences conjugales – Poils&Capitons.
Un calendrier de l’histoire de l’humanité selon Eduardo Galeano
Trouvé surle site Global Voices:
Eduardo Galeano, l’un des écrivains les plus éminents d’Amérique Latine, est mort ce lundi. Il est l’auteur de Les Veines ouvertes de l’Amérique Latine, Mémoire du feu (trilogie), Miroirs et beaucoup d’autres titres. Son dernier livre Children of the Days: A Calendar of Human History (Enfants des jours: calendrier de l’histoire de l’humanité) vient d’être publié en anglais en livre de poche chez Nation Books et n’est pas encore traduit en français. A World of Violence: On Women Who Refused to Live in Silence and Be Consigned to Oblivion (Un monde de violence: à propos des femmes qui refusent de se taire et d’être condamnées à l’oubli) est un extrait du livre. Galeano a reçu de nombreux prix internationaux dont le premier Prix Lannan pour la Liberté de la Culture, l’American Book Award, et le Prix Casa de las Américas.
La chaussure
(15 janvier)
En 1919, Rosa Luxembourg, la révolutionnaire, a été assassinée à Berlin.
Ses assassins l’ont matraquée à mort à coups de crosses de fusil et l’ont ensuite jetée dans les eaux d’un canal.
En chemin, elle a perdu une chaussure.
Une main inconnue a ramassé cette chaussure tombée dans la boue
Rosa aspirait à un monde où la justice ne serait pas sacrifiée au nom de la liberté, pas plus que la liberté au nom de la justice.
Chaque jour, une main inconnue relève le flambeau.
Tombé dans la boue, comme la chaussure.
La fête ratée
(17 février)
Les ouvriers agricoles qui travaillaient sur les fermes de Patagonie en Argentine se sont mis en grève pour protester contre des salaires de misère et des journées de travail sans fin. L’armée a chargé pour rétablir l’ordre.
Les exécutions sont exténuantes. En cette nuit de 1922, les soldats épuisés par la tuerie sont allés au bordel du port de San Juliàn pour une récompense bien méritée.
Mais les cinq femmes qui travaillaient là leur ont fermé la porte au nez et les ont chassés aux cris de “Assassins! assassins, dehors!”
Osvaldo Bayer a noté leurs noms. Il s’agit de Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache, et Maud Foster.
Les putains vertueuses.
Femmes sacrilèges
(9 juin)
En 1901, Elisa Sánchez et Marcela Gracia se sont mariées à l’église Saint-Georges de la Corogne en Galice.
Elisa et Marcela s’aimaient en secret. Pour faire les choses dans les règles, avec une cérémonie, un prêtre, une autorisation et des photos, il a fallu inventer un mari. Elisa est devenue Mario: elle s’est coupé les cheveux, s’est habillée en homme et a déguisé sa voix.
Quand l’histoire a été dévoilée au grand jour, dans toute l’Espagne les journaux ont juré leurs grands dieux – “c’est un scandale écœurant, d’une immoralité sans nom” – et ont profité de cette occasion lamentable pour faire des records de ventes de leurs journaux, pendant que l’Église, trompée dans sa bonne foi, dénonçait le sacrilège à la police.
Et la cavale a commencé.
Elisa et Marcela ont fui au Portugal.
Elles ont été rattrapées à Porto et emprisonnées.
Le droit au courage
(13 août)
En 1816, le gouvernement de Buenos Aires a promu Juana Azurduy au rang de lieutenant colonel “en raison de ses efforts dignes d’un homme”.
Elle a mené la guérilla qui a pris Cerro Potosí aux espagnols durant la guerre d’indépendance.
La guerre était une affaire d’hommes et les femmes n’avaient pas le droit d’y participer, mais les officiers masculins ne pouvaient pas s’empêcher d’admirer “le courage viril de cette femme”.
Après des milliers de kilomètres à cheval, après la mort de son mari et de 5 de ses 6 enfants à la guerre, Juana s’est éteinte. Elle est morte dans la pauvreté, pauvre parmi les pauvres, et elle a été enterrée dans une fosse commune.
Près de deux siècles plus tard, le gouvernement argentin, mené par une femme, l’a promue au rang de général, “en hommage à son courage de femme”.
Les femmes qui ont libéré le Mexique
(17 septembre)
Les fêtes du centenaire se terminent et toutes ces bêtises éclatantes sont balayées.
C’est là que commence la révolution.
L’histoire se souvient des chefs révolutionnaires comme Zapata, Vila et bien d’autres hommes. Les femmes, qui se sont tues, sont tombées dans l’oubli.
Quelques combattantes ont refusé de disparaître:
Juana Ramona, “la Tigresse,” qui a pris d’assaut plusieurs villes;
Carmen Vélez, “la Générale”, qui commandait 300 hommes;
Ángela Jiménez, pour qui la dynamite n’avait pas de secrets, s’est fait appeler Angel Jiménez;
Encarnación Mares,qui a coupé ses tresses et est devenue sous-lieutemant en se cachant derrière les bords de son grand sombrero, “pour que l’on ne voit pas ses yeux de femme”;
Amelia Robles, qui est devenue Amelio et qui a atteint de grade de colonel;
Petra Ruiz, qui est devenue Pedro et qui a tiré plus que quiconque pour forcer l’ouverture des portes de Mexico;
Rosa Bobadilla, une femme qui a refusé de devenir un homme et a participé à plus d’une centaine de batailles;
et María Quinteras,qui avait fait un pacte avec le diable et qui n’a pas perdu une seule bataille. Les hommes, dont son mari, obéissaient à ses ordres.
La mère des femmes journalistes
(14 novembre)
Un matin de 1889, Nellie Bly s’est mise en route.
Jules Verne ne croyait pas que cette jolie petite femme était capable de faire le tour du globe toute seule en moins de 80 jours.
Mais Nellie a embrassé le monde en 72 jours, et tout au long de son périple, elle a publié article sur article pour raconter ce qu’elle entendait et ce qu’elle voyait.
Ce n’était pas le premier exploit de la jeune reporter et ce ne serait pas le dernier.
Pour écrire sur le Mexique, elle est devenue si Mexicaine que le gouvernement mexicain naissant l’a déportée.
Pour écrire sur les usines, elle a travaillé à la chaîne.
Pour écrire sur les prisons, elle s’est fait arrêtée pour vol.
Pour écrire sur les asiles d’aliénés, elle a si bien feint la folie que les médecins l’ont internée. Ensuite elle a dénoncé les traitements psychiatriques qu’elle a subis et qui sont une raison suffisante pour vous rendre fou.
À Pittsburgh, quand Nellie avait vingt ans, le journalisme était une affaire d’hommes.
C’est à cette époque qu’elle a eu l’insolence de publier ses premiers articles.
Trente ans plus tard, elle a publié son dernier, en échappant aux balles en première ligne de la 1ère guerre mondiale.
Mais ils en ont réchappé. Ils ont changé de nom et pris la mer.
Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence contre les Femmes
(25 novembre)
Dans la jungle de la Paranà supérieure, les plus beaux papillons survivent en se montrant. Ils étalent leurs ailes noires rehaussées de taches rouges ou jaunes, et volètent de fleur en fleur sans la moindre crainte. Après des milliers et des milliers d’années, leurs ennemis ont appris que ces papillons sont venimeux. Les araignées, les guêpes, les lézards, les mouches et les chauve-souris les admirent à distance.
En cette journée de 1960 trois activistes opposées au dictateur Trujillo en République Dominicaine ont été battues et jetées d’une falaise. Il s’agit des sœurs Mirabal. Elles étaient très belles et on les appelait Las Mariposas, “Les papillons”.
En leur mémoire, en souvenir de leur indicible beauté, ce jour est la Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence contre les Femmes. En d’autres termes pour l’élimination de la violence perpétrée par les petits Trujillos qui font la loi dans tant de foyers.
L’art de vivre
(9 décembre)
En 1986, le Prix Nobel de Médecine a été attribué à Rita Levi-Montalcini.
Pendant une époque troublée, sous la dictature de Mussolini, Rita a secrètement étudié les fibres nerveuses dans un laboratoire de fortune caché chez elle.
Des années plus tard, après un travail énorme, cette détective des mystères de la vie a découvert la protéine qui multiplie les cellules humaines, ce qui lui a valu le Prix Nobel.
Elle avait près de 80 ans quand elle a dit “Mon corps est ridé, mais pas mon cerveau. Quand je ne pourrai plus penser, tout ce que je demande c’est que l’on m’aide à mourir dans la dignité”.
Cet article est paru sur TomDispatch. Mark Fried a traduit en anglais sept livres d’Eduardo Galeano, dont Les Enfants des Jours. Il a également traduit, parmi tant d’autres, Luciole de Severo Sarduy. Il vit à Ottawa, Canada.
Écrit par NACLA. Traduit par Marie André
La militante palestinienne Khalda Jarrar a été arrêtée !
 Nous relayons ce communiqué du Collectif Coup Pour Coup 31 (via Quartiers libres):
Nous relayons ce communiqué du Collectif Coup Pour Coup 31 (via Quartiers libres):
Très tôt ce matin, jeudi 2 Avril, plus de 60 soldats de l’occupation israéliennes ont attaqué la maison de la parlementaire palestinienne Khalida Jarrar, une dirigeante de la gauche palestinienne et féministe. Elle a été brutalement arrêtée, l’armée est rentrée chez elle à coups de pied dans la porte d’entrée et tenant son mari dans une chambre séparée.
Dirigeante du Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP), Khalida Jarrar a résisté à la volonté de l’armée d’occupation de l’expulser de Ramallah à Jéricho pour six mois en septembre 2014.
Qui est Khalida?
Khalida est une avocate palestinienne, spécialisée dans la défense des prisonniers palestiniens au sein du réseau Addamer. Elle préside le Comité du Conseil législatif palestinien des Prisonniers. Elle est également active dans le mouvement des femmes palestiniennes, une voix féministe de premier plan pour la défense des droits des femmes.
Depuis 1998, elle est interdite de voyager à l’extérieur de la Palestine occupée; en 2010, alors qu’elle avait besoin d’un traitement médical en Jordanie, elle a lutté pendant des mois dans une campagne publique avant de finalement recevoir son traitement.
En août septembre 2014, une campagne internationale en soutien à Khalida Jarrar fut lancée, exigeant l’annulation de « l’ordonnance de surveillance spéciale » et de son transfert forcé de Ramallah à Jéricho. Jarrar a refusé l’expulsion à Jéricho. Au lieu de cela, elle a mis en place une tente de protestation dans la cour du Conseil législatif palestinien à Ramallah, où elle a vécu et travaillé jusqu’à ce que l’ordonnance fût levée le 16 Septembre, 2014. « C’est l’occupation qui doit quitter notre patrie », a déclaré Jarrar. La tente a été visitée par de nombreuses délégations palestiniennes et internationales, y compris les membres internationaux du Parlement.
Aujourd’hui, Il y a 18 membres du Conseil législatif palestinien élu emprisonnés par Israël, 9 en détention administrative sans procès ou sans charge. Les membres du CLP ont été à plusieurs reprises et systématiquement ciblé par les forces d’occupation israéliennes.
La campagne Khalida Jarrar solidarité est réactivée pour exiger sa libération immédiate.
Libérez Khalida Jarrar !
Palestine vivra, palestine vaincra !
Des féministes contre la loi de 2004 sur le voile à l’école
Ok, elle s’appelle « loi contre le port des signes religieux dans les établissements scolaires ». Tout le monde comprend: contre le voile – ou comment l’État français a légitimé l’islamophobie. Des féministes lancent aujourd’hui une pétition pour l’abrogation de cette loi. Corps et politique ne peut que s’y associer! Voici le texte, et le lien vers le site ou signer en ligne.
Nous sommes féministes, nous défendons tous les jours les droits des femmes, et nous pensons qu’il faut abroger la loi de 2004 contre le port des signes religieux dans les établissements scolaires.
La question n’est pas de savoir ce que les féministes que nous sommes pensent de la religion en général, ou de l’Islam en particulier, quel sens symbolique ou politique nous donnons au port du foulard islamique, qu’il soit volontaire ou imposé. La question, c’est qu’encore une fois on relègue les femmes au statut de victime, et qu’on propose de les exclure pour mieux les libérer. Encore une fois le corps des femmes est un champ de bataille, une ligne de front sur laquelle s’affrontent des idéologues au nom de leur libération. Et c’est aux filles et aux femmes musulmanes que la France demande de payer le prix de la laïcité. Aujourd’hui, dix ans après le vote de cette loi, qu’a-t-on gagné ? Combien de discriminations et de violences ont été commises en son nom ? Des femmes voilées ont été agressées. Des mères ont été discriminées. A ce prix, la France est-elle devenue plus laïque ? Non. Le port du voile a-t-il régressé, comme les promoteurs de cette loi l’espéraient ? Non. Des filles ont été exclues de l’école. Les camps se sont durcis. La violence contre les femmes a augmenté.
Nous sommes féministes et nous croyons que sommer des filles de dix ans de choisir un camp entre famille et école, entre la religion et la laïcité forcée, n’est pas la solution dont ces filles ont besoin pour s’émanciper. « Ne me libérez pas, je m’en charge » ! dit un vieux slogan féministe. Car ce n’est pas comme ça qu’on libère, c’est comme ça au contraire qu’on contribue à aliéner ceux qu’on prétend libérer. Le corps des femmes n’appartient à personne, pas plus à ceux qui veulent lui imposer le voile qu’à ceux qui veulent le lui retirer de force. Ce n’est pas en arrachant le voile d’une écolière ou en la chassant de l’école publique qu’on fera reculer le sexisme, bien au contraire.
Laissons les filles tranquilles ! Laissons-les réfléchir et discuter ensemble des voies et moyens de leurs propre libération, qu’il s’agisse de se libérer de la norme sexiste, du dogme hétérosexuel ou des interdits religieux, de la symbolique de tel fichu ou de tel chiffon, de la morale et du sacré, des injonctions à montrer ou cacher son corps et ses désirs. Et quoi de mieux pour cela que les bancs et la cour d’une école ?
L’école ne peut pas tout faire, mais elle est le lieu d’émancipation par excellence, parce que chacun peut en principe y accéder à un corpus commun de savoirs, quelle que soit la culture religieuse dans laquelle il ou elle a grandi. C’est là en principe que l’on découvre l’autre, les autres, et qu’on façonne à leur contact sa propre identité. On y apprend que les uns sont athées, les autres pratiquants, les unes juives, catholiques, protestantes, hindoues, les autres musulmanes, les unes hétéros, les autres homosexuelles, filles, garçons ou trans, les uns d’une couleur, les autres d’une autre. Le rôle de l’école laïque est d’accueillir chacun et chacune avec ses différences, ses hontes et ses fiertés, ses secrets de famille, ses croyances et ses doutes. Le rôle de l’école laïque est de veiller à ce que toutes les souffrances puissent s’exprimer sans crainte, et non de préjuger de qui doit être libéré. Le rôle de l’école laïque est de faire preuve de bienveillance et d’ouverture, pas d’imposer d’en haut des valeurs qui n’auraient d’universelles que le nom, puisqu’elles se fonderaient sur l’exclusion.
Faut-il le rappeler ? Depuis 1905 et jusqu’au vote en 2004 de la loi contre le port des signes religieux dans les écoles, l’obligation de neutralité religieuse n’incombait qu’à l’État et à ses fonctionnaires, pas à ses citoyens. Aujourd’hui, en France, la laïcité prend trop souvent la forme d’une religion d’État au service de l’exclusion des filles et des minorités. Si c’est cette laïcité dogmatique – sacralisée – qui doit être inculquée demain aux enfants de France, ce ne sera pas en notre nom. Nous sommes féministes. Nous demandons le retrait de la loi qui interdit le port des signes religieux dans les établissements scolaires.
Une interview de Morgane Merteuil
Le site Lundi matin publie cette semaine la première partie d’un entretien avec Morgane Merteuil, porte-parole du Syndicat du travail sexuel. On peut l’écouter par ici.
À propos de Sorcière, sorcières
Voici un article publié par Céline Laurens dans la revue en ligne Syntone, à propos de l’émission Sorcière, sorcière dont Corps et politique avait déjà parlé ici.
Réalisé par Élisa Monteil et Raphaël Mouterde pour l’album sonore accompagnant « Marabout », le premier numéro de la revue Jef Klak, Sorcière, sorcières est un double récit à la première personne. Première face du récit : l’héroïne, interprétée par Élisa Monteil, énonce une lettre d’apostasie s’adressant tour à tour au Christ, aux inquisiteurs du XIVe siècle, aux médecins du XIXe, enfin aux autorités religieuses contemporaines. Nous comprenons peu à peu les motivations de la demande solennelle de la jeune femme à être retirée des registres de l’église catholique. Puis, deuxième face du récit, elle découvre des archives de la chasse aux sorcières s’échappant par bribes de vieux magnétos à bande, manuscrits et poste de radio.
Bois grinçants, gonds et pênes de poignées rouillés, plancher crissant… : des éléments kaléidoscopiques récurrents permettent de situer l’action dans un espace imaginaire – un grenier ? – tout au long de ce récit éclaté. Car à partir des deux trames (l’adresse de la lettre et les éléments d’archives), des fenêtres s’ouvrent vers d’autres mondes : souvenirs en flash back, situation documentaire, paysages naturalistes virant au surréalisme. Les prises de sons, qu’il s’agisse de paysage ou de mise en scène, offrent des images cinématographiques. Elles donnent une sensation de réalisme que le bruitage ne parviendrait pas à restituer. « Toutes les prises de son des saynètes sont réalisées en condition de tournage cinéma in situ », nous confie Raphaël Mouterde. Quand aux trames musicales, qu’elles soient électroacoustiques, glam rock, ou qu’elles suivent l’allure régulière de beats électro, elles épousent chaque situation et donnent du souffle au récit. Le travail sur l’intensité, l’intonation et la tessiture des voix donne le relief et la profondeur de champ nécessaires. Les jeux de superposition, distorsion, réverbération et panoramique des voix amplifient l’ouverture de l’espace sonore.
À la fois essai historique et Hörspiel, Sorcière, Sorcières ne se contente pas d’être un étendard. C’est l’histoire singulière d’un personnage fictionnel (autofictionnel ?) véritablement incarné : la jeune femme se souvient, sent, ressent, s’insurge. Elle se raconte dans son rapport intime à la religion. L’eau, le cri, le prêtre, ces trois éléments souvenirs de son baptême sont transposés quatorze ans plus tard dans la deuxième saynète de la pièce. La jeune femme, plongée dans sa baignoire, ne crie plus de peur mais suffoque de plaisir. L’image du prêtre est devenue support fantasmatique. Enfant soumise à l’autorité religieuse, maintenant adolescente, elle commet l’acte répréhensible en s’adonnant au plaisir de la chair.
Rituel d’inversion sociale : en se réappropriant son corps par un geste interdit, elle répare toute une lignée de femmes, torturées et mortes avant elle.
En plein cœur de la pièce à douze minutes, est scandée une longue énumération de femmes brûlées, décapitées, torturés, écartelées (ayant toutes réellement existé) qui évolue vers un slam électrique où les effets de saturation distordent la voix de la narratrice. Immédiatement, nous retrouvons pourtant sa voix dans un tout autre contexte. Une vieille amie paysanne de la famille enseigne à la narratrice une formule, la guide dans les gestes à faire : « toujours avec la main gauche, la main du cœur. » La scène se détache des registres jusque-là mis en place : je sens que je n’ai pas affaire à des actrices. Documentaire ? Fiction ? Autofiction ? Je suis troublée : je ne sais plus si Élisa Monteil joue le rôle du personnage ou si elle glisse des éléments autobiographiques. Interrogée, elle nous confie : « Ce qu’il y a d’enthousiasmant dans ces nouvelles formes de narration sonore, c’est justement la recherche de l’équilibre entre l’expression d’un fragment personnel et la fiction. La responsabilité de l’auteur⋅e est au premier plan. Il ou elle ne se cache pas derrière une personne interviewée. » En tant que femme, l’auteure est concernée dans son identité. Elle s’engage intimement dans le récit. En m’identifiant à elle, je m’identifie dans le même mouvement à toutes les insoumises.
En conclusion de Sorcière, sorcières, un nouveau processus d’accumulation slamé est repris. Il s’agit d’un extrait d’un film de Camille Ducellier, Sorcières, mes sœurs. Les noms des victimes passées résonnent alors par cet effet de symétrie avec ceux de leurs héritières contemporaines « des ouvrières en colères, des vierges rouges, des folles à lier, des avorteuses, des bikeuses, des camionneuses, des poilues, (…) toutes des sorcières ». La chasse reste ouverte. L’ennemi intérieur est toujours combattu par le rouleau compresseur d’une modernité normative. L’intuition, indomptable, prend de nouveaux visages. Qui étaient les sorcières, qui sont les sorcières ? De terribles femmes maléfiques ? Des résistantes ouvrant des espaces pour que l’air soit respirable ?
Je suis tenue en haleine durant toute la pièce grâce à la richesse et la diversité des matériaux qu’elle réunit. Le montage permet de glisser d’un plan à l’autre, d’une émotion vive à un moment sensuel, poétique, ou ludique avec les ritournelles des enfants. Cet essai-fiction, tant par ses prises de risques narratifs que par son propos, donne à penser les processus de stigmatisation à travers le temps. Avec force, il invite à plus d’autonomie face aux institutions des pouvoirs dominants.
Céline Laurens
Les Gracieuses : un film de Fatima Sissani en projection à Forcalquier
En collaboration avec Radio Zinzine, Agate, Armoise et Salamandre présente
Les Gracieuses, un film documentaire de Fatima Sissani
 au cinéma le Bourguet
au cinéma le Bourguet
le vendredi 3 avril 2015 à 18h30
Prix : 5 euros
La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice
Les Gracieuses
un film de Fatima Sissani / 79 minutes. Six jeunes femmes. Proches de la trentaine.Elles sont nées dans le même immeuble de la cité des Mordacs à Champigny Sur Marne,banlieue ouest. Elles ne se sont pas quittées depuis l’enfance. Une relation fusionnelle. Elles racontent, joyeuses et à toute vitesse, cette amitié presque amoureuse et aussi l’identité,les rapports de classe, la relégation spatiale, sociale….
Mon corps a-t-il un sexe?
Note de lecture : Mon corps a-t-il un sexe ? Sur le genre, dialogues entre biologies et sciences sociales
Sous la direction de Évelyne Peire et Joëlle Wiels
La Découverte, coll. Recherches, 2015.
« Ce livre est le fruit du colloque international qui s’est tenu à Paris les 22 et 23 juin 2011, à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). » Comme l’indique le sous-titre, il s’agissait de croiser les savoirs en biologie (réputée science « dure », ou « exacte ») et en sciences sociales (nécessairement « approximatives », voire « molles ») sur le sexe et le genre. Les directrices de l’ouvrage préviennent dans leur introduction que son objectif « n’est pas de nier qu’il existe des femelles et des mâles et que les individus de ces deux catégories sont capables de produire des gamètes différents (ovules ou spermatozoïdes) dont la fusion permet, à terme, la procréation d’un nouvel être. » L’objectif est plutôt « de mieux comprendre comment, au-delà de la réduction binaire, la société gère ces notions de mâles et de femelles. » Et, bien sûr, « comment, notamment, elle construit des places différentes et les assigne aux personnes selon un système hiérarchisé, ou genre, femme/homme, et comment elle (mal) traite les personnes qui n’entrent pas dans ces deux catégories. »
Difficile de rendre compte de façon synthétique d’un pareil ensemble de textes (une vingtaine au total, sans compter l’introduction et la conclusion, ni la postface d’Éric Fassin) dont les sujets couvrent un large éventail, depuis la biologie et la génétique « pures et dures », jusqu’aux questions épineuses de l’identité et des représentations. On se contentera donc ici de picorer ça et là quelques informations, en recommandant aux personnes intéressées par ces thématiques une lecture plus approfondie de ce livre vraiment très instructif.
Dans la première partie, intitulée « Construction du corps sexué », l’article de Joëlle Wiels, « La détermination génétique du sexe : une affaire compliquée », montre à la fois la complexité encore très mal connue des « processus qui contrôlent la détermination du sexe durant l’embryogenèse » et le rôle important des « présupposés idéologiques » dans la recherche sur ce sujet. Après une explication technique de ces processus et de la recherche menée depuis quelques décennies, l’auteure constate que « si l’on examine d’un œil un peu critique l’ensemble des recherches [en génétique] menées sur la détermination du sexe » durant une bonne trentaine d’années, « il apparaît tout de suite que leur but n’était pas de trouver les mécanismes contrôlant la formation des deux gonades (ovaires et testicules) mais seulement d’identifier le facteur déclenchant la différenciation du seul organe vraiment important : le testicule. » Ainsi, le sexe femelle serait-il un sexe « par défaut ». Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette tendance s’est affirmée dans la littérature scientifique des années 1970, alors qu’elle était moins marquée dans les publications des années 1960. L’auteure en donne un petit florilège, dont on ne retiendra ici que cette citation – mais les autres sont du même tonneau : « Le mode de développement femelle peut être considéré comme le schéma “par défaut” de développement du corps, schéma qui peut être contrecarré par la formation des testicules , afin de produire un mâle [Smith, 1994]. » Ces affirmations étaient reprises de manière acritique dans la presse « grand public », ainsi de La Recherche : « Comme tous les chromosomes, le chromosome Y contient de l’ADN, sur lequel se trouvent des gènes dont sans doute le gène de détermination du sexe. […] Le gène TDF (pour Facteur de Détermination des Testicules) contrôle la détermination du sexe. » Ainsi, conclut l’auteure, « les stéréotypes de genre, où tout ce qui relève du masculin domine implicitement le féminin, s’avèrent donc bien présents dans le monde de la recherche sur la détermination du sexe et ont des effets non négligeables sur le développement de ces études. » À ces effets, il faut ajouter ceux, engendrés en cascade, pourrait-on dire, sur le grand public, via la vulgarisation, comme on l’a vu avec l’exemple cité de La Recherche, mais aussi à travers les programmes éducatifs, qui reprennent en les simplifiant les résultats de la recherche scientifique. C’est ainsi qu’on peut parler d’un cercle vicieux de (re)production du genre : les a priori des chercheurs orientent leurs travaux et leurs conclusions dans un sens bien précis, lequel est repris par la presse et les instances éducatives, lesquelles (re)produisent des a priori dans la tête des futurs chercheurs… Il faut d’ailleurs noter que, si depuis les années 2000, la recherche, et la presse à sa suite, ont nuancé leurs avis sur la question, dans les manuels scolaires, le sexe femelle se développe toujours par défaut, « en l’absence de chromosome Y » (dont la présence détermine le sexe mâle).
On retrouve les mêmes a priori dans le domaine des études sur le cerveau. Et cela encore tout récemment puisque c’est en 2005 que Laurence Summers, président de l’université américaine de Harvard, déclarait que « le faible nombre de femmes dans les disciplines scientifiques s’explique par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. » Catherine Vidal, qui commence son article, « Le cerveau a-t-il un sexe ? (deuxième partie du livre : « Le sexe envahit tout le corps ») par cette citation, poursuit en disant que « le propos a fait scandale dans les milieux universitaires, féministes et scientifiques ». Pour autant, il ne fait que s’inscrire dans une tradition bien enracinée. Ainsi, écrivait Broca en 1861, « on s’est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l’homme. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle ». Heureusement, toutes les découvertes récentes sur la plasticité cérébrale vont à l’encontre de ces affirmations. Ainsi, par exemple, « si l’on fait le bilan des études en IRM sur les fonctions cognitives réalisées depuis quinze ans, on constate que sur 11 000 publications, seulement 2,6% ont montré des différences entre les sexes. » De fait, ajoute Catherine Vidal, « les différences entre les cerveaux de personnes d’un même sexe sont tellement importantes qu’elles l’emportent sur les différences entre les sexes qui, en conséquence, font figure d’exception. » Ceci s’explique par le fait que si un nouveau-né possède déjà 100 milliards de neurones à la naissance, lesquels cessent dès lors de se multiplier, les connexions entre ces neurones, les synapses, commencent à peine à se former – et on estime leur nombre à un million de milliards chez l’adulte ! « Or, seulement 6 000 gènes interviennent dans la construction du cerveau. Cela signifie qu’il n’y a pas assez de gènes pour contrôler la formation de nos milliards de connexions. Le devenir de nos neurones n’est pas inscrit dans le programme génétique. » (C’est moi qui souligne.) La conclusion logique de ces observations est que le cerveau est « un organe dynamique qui évolue tout au long de la vie. Rien n’y est à jamais figé, ni programmé à la naissance. » Le genre pas plus que le reste.
Dans la troisième partie du livre, « Cultures/Natures : la femelle et le mâle », Michel Kreutzer, avec son texte « Des animaux en tout genre », montre que les a priori déjà évoqués se sont tout aussi bien appliqués aux mondes animaux, en ce qu’ils ont longtemps été réduits à une vie guidée par les instincts reproductifs, principalement. Les sciences de la nature ont construit un système de classification des espèces basé sur la notion de typicalité, gommant toute diversité à l’intérieur de cette espèce, « pour bien souvent ne reconnaître qu’une seule dualité, celle qui oppose les mâles et les femelles ». Cependant, les plus récentes études sur la question montrent que les animaux, loin d’être des quasi machines prédéterminées par leur gènes, ont, à l’instar des humains, une vie sociale et une psychologie. « Certains rôles sociaux, dit Kreutzer, relèvent précisément du genre. » Ainsi, les comportements parentaux varient selon les espèces – chez certaines, ce sont les mâles qui s’occupent de leur progéniture, chez d’autres, ce sont les femelles, chez d’autres encore les mâles et les femelles, et encore, on relève de nombreux cas où ces rôles, naguère pensés comme immuables, peuvent varier à l’intérieur d’une même espèce animale. Plus, on observe aussi des couples de « lesbiennes » chez les goëlands : une fois fécondées par un mâle, deux femelles nidifient ensemble et élèvent elles-mêmes leurs petits. Chez les cygnes noirs, ce sont des mâles gays qui, une fois les œufs pondus par une femelle, l’expulsent et s’occupent de la couvaison puis de l’élevage des jeunes… Autant dire qu’il nous reste beaucoup à découvrir sur les mondes animaux, et à réfléchir sur la canonique opposition entre nature et culture.
La question de l’intersexualité est justement l’une de celles qui font vaciller cette limite. Vincent Guillot intervient à ce propos dans la quatrième partie du livre, « De l’identité aux représentations ». On ne peut que recommander de lire ce texte, qui s’intitule « Me dire simplement », et qui commence ainsi : « Lorsqu’on m’invite comme témoin, j’entends “tu es moins, nous sommes plus”. Je ne peux donc que me dire, me dévoiler et, en retour, vous direz qui nous sommes. Or, il me semble qu’au sujet de l’intersexualité, la question n’est pas “celui-qui-est-moins” mais “celui-qui-se-pense-plus”. Ce n’est pas nous que vous interrogez mais vous que vous n’osez pas questionner – votre corps, votre sexe, vos pratiques sexuelles et amoureuses, vos fantasmes et vos phobies. Et cela, de façon récurrente, tant le corps médical comme le milieu universitaire considèrent la question “intersexe” comme extrêmement compliquée. À mon sens, il n’en est rien, c’est vous qui la rendez complexe, vous qui êtes compliqués. »
Voici en somme un livre passionnant, certes difficile à lire d’une traite, car touffu et divers, mais dont chaque partie et chaque article apportent de précieuses informations et suscitent la réflexion.
Pas au nom du féminisme !
Contre un projet d’interdire le port du voile à l’université
(tribune de Julie Pagis publiée dans Libération)
C’est à ce titre que l’exclusion des filles voilées de l’école primaire avait été condamnée par le Conseil d’Etat, lors de la première «affaire du voile» en 1989, comme une forme de discrimination religieuse contraire au principe de laïcité garanti par la Constitution. L’évolution du contexte sociopolitique et la progressive fabrique du «problème musulman» (1) ont rendu possible la remise en cause de cette décision par la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux dans les établissements primaires et secondaires publics. Et l’on assiste, depuis, à une progressive exclusion des femmes portant le foulard de la sphère scolaire et économique (des employées de crèches privées subventionnées, aux mères d’élèves interdites d’accompagner les sorties scolaires par la circulaire Châtel de 2012), au nom d’acceptions toujours plus extensives de la «mission de service public».
La proposition d’interdiction du voile dans l’enseignement supérieur correspond ainsi à une étape supplémentaire du processus de discrimination légale par capillarité analysé par les sociologues Hajjat et Mohammed (1). Si elle a été désavouée par M. Valls (pour l’instant), elle n’en porte pas moins la potentialité d’un racisme et d’un sexisme d’Etat.
Mais d’où vient, et à quoi sert, cette proposition ? Elle n’est pas issue de la communauté universitaire qui n’a jamais constitué cette question en «problème», contrairement à celles du harcèlement sexuel et du sexisme à l’université, de la casse des services publics d’enseignement, de la fermeture des services sociaux et médicaux à destination des étudiants ou encore de l’absence de crèches dans les universités, rappelées dans la pétition susmentionnée.
Ce n’est donc pas dans le champ académique que se situe la genèse de cette proposition de loi, mais dans le champ politique et dans la concurrence qui s’y joue entre professionnels de la politique. Mme Boistard reprend cette proposition, à quelques semaines des élections départementales, à certains ténors de la droite, à des fins électoralistes à peine voilées (sans jeu de mots) : en préemptant la thématique de la stigmatisation des musulmans à ses adversaires (la droite l’ayant déjà reprise au FN), le PS espère récupérer des voix auprès d’un électorat qui ne lui est pas traditionnellement acquis. On ne peut que souscrire au constat d’une déshérence idéologique profonde du PS – analysé dans les travaux de Rémi Lefebvre sur le PS (2) – dans un contexte où cette «gauche» a abandonné ses valeurs et propositions (quid du vote des étrangers aux municipales ? de la PMA ? de la renégociation du traité européen pour privilégier la croissance et l’emploi ?) pour se ranger à l’austérité.
Alors, s’il vous plaît, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ayez au moins la décence de ne pas dissimuler vos errances électoralistes sous le voile du féminisme ! Et n’allez pas crier au loup au soir du 22 mars si d’aventure le FN venait à faire un score élevé : vos politiques d’austérité et de stigmatisation des jeunes des quartiers populaires font le lit de l’extrême droite qui a toujours prospéré sur la misère sociale et la recherche d’un ennemi intérieur, que vous leur servez là, sur un plateau d’argent.
(1) «Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman »», par Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, La Découverte, 2013. (2) «Les Primaires socialistes : la fin du parti militant», éd. Raisons d’agir, 2011.
Julie Pagis est chercheure en sociologie politique au CNRS.
Lettre ouverte à la Secrétaire d’Etat aux droits des femmes – Madame Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat déléguée aux droits des femmes : Non à l’interdiction du voile à l’université – 7 mars 2015
Madame la Secrétaire d’Etat déléguée aux droits des femmes,
Nous appartenons à la communauté universitaire et sommes toutEs en charge d’une mission de service public qui, au-delà de la formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, participe à construire un espace démocratique qui au jour le jour s’invente comme un espace de dialogues, de débats ; un espace traversé d’antagonismes (y compris avec nos présidences et conseils d’administration), mais aussi de solidarités, un espace ouvert sur le monde dont nous héritons en commun, une agora qui se recrée à chaque heure dans nos amphis, dans nos « cafèts », sur nos parvis ou les murs de nos campus, et ce, malgré les conditions matérielles déplorables qui sont celles de nos institutions. S’il y a bien un lieu dans notre République, où la liberté de pensée et d’expression, ou plutôt, le droit de cité se vit ici et maintenant, c’est encore au sein des universités – et même les tentatives qui ont visé à mettre à mal cette liberté autogérée (en envoyant ces dernières années les forces de l’ordre traditionnellement interdites dans nos espaces en cas de conflit, de contestation ou d’occupation), ne sont pas parvenues à nous désespérer de penser la complexité du monde social et les enjeux du vivre en commun, comme à en expérimenter les conditions possibles.
Or, vous ne pouvez ignorer que depuis plus de dix ans le voile, sur lequel vous vous exprimiez encore récemment, est une question qui n’a fait qu’instrumentaliser à moindres frais les droits des femmes au profit de politiques racistes, aux relents paternalistes et colonialistes – définissant pour les femmes de bonnes manières de se libérer, blanchissant une partie des associations féministes en les dédouanant de s’engager contre le racisme y compris dans leurs propres rangs et, inversement, en permettant à des associations dites « communautaires » d’assimiler le féminisme au bras armé de vos politiques islamophobes. La classe politique et votre parti, en exposant aux discriminations les plus brutales des femmes portant le voile (lynchages de jeunes filles, de femmes enceintes et de mères, discriminations à l’embauche, exclusions des écoles publiques, etc.), a fait le lit des nationalismes et doit être tenu pour responsable d’une situation de tension sociale sans précédent.
Vous avez déclaré, en tant que secrétaire d’Etat aux droits des femmes, être « contre le voile à l’université ». Indépendamment de l’inactualité nauséabonde d’une telle prise de position, comment pouvez-vous, « au nom des droits des femmes », vous exprimer contre la liberté et l’égalité entre toutes les femmes ? Comment pouvez-vous considérer qu’il serait pertinent dans ce cadre d’exposer une partie des étudiantes aux rappels à l’ordre des instances dirigeantes des universités ou de quelques mandarins en mal de « mission civilisatrice », pourvus d’un droit discrétionnaire à exclure et à réglementer un droit de cité inaliénable et non négociable ?
Vous acceptez ainsi d’être la porte parole – non pas des femmes – mais d’entrepreneurs de leur seule carrière politique et médiatique, pourvoyeurs de haine et de fantasme. A l’opposé d’une telle rhétorique, en tant que Secrétaire d’Etat déléguée aux droits des femmes, votre mission et votre responsabilité, si vous souhaitez vous intéresser à l’université, seraient pourtant des plus nobles mais aussi des plus considérables : depuis des années, aucune politique publique n’a souhaité financer à hauteur de nos besoins un véritable plan national de lutte contre le harcèlement sexuel et le sexisme à l’université, aucune action efficace, pérenne, n’a visé à lutter contre les exclusions et la paupérisation des étudiantEs ou des personnels administratifs – qui sont en grande majorité des femmes, et qui assurent au jour le jour nos conditions d’études.
Vous voulez œuvrer pour le droit des femmes à l’université ? Remettez en place un service de médecine universitaire digne de ce nom à même de fournir une information et des soins notamment relatifs aux droits reproductifs toujours plus menacés par la « crise » ; assurez-vous que les services sociaux à destination des étudiantEs et des personnels ne soient pas systématiquement la première ligne budgétaire que nos présidents et CA suppriment, que des transports publics desservent nos campus dans des conditions acceptables et que des logements décents pour étudiantEs soient construits en nombre suffisant, ou même, ouvrez des crèches dans nos universités pour permettre à toutes les femmes de venir travailler, étudier et se former.
Enfin, vous voulez discuter des droits des femmes, de liberté, d’égalité ? Des questions de genre, des droits des minorités sexuelles et raciales, des rapports sociaux tels qu’ils s’articulent aux politiques néolibérales de destruction des services publics et de privatisation des biens communs (qui transforment le savoir en marchandise par le biais de politiques que le PS relaie depuis des années) ? Venez dans nos cours et nos séminaires, dans nos départements, nos équipes de recherche, écoutez les enseignantEs, les étudiantEs, voiléEs, pas voiléEs, qui débattent, construisent ensemble une pensée critique à même de servir les connaissances qui nourriront les bibliothèques de demain comme les luttes menées en commun pour faire advenir un monde meilleur dont vous semblez avoir déjà fait le deuil.
Le 6 mars 2015
Comme une tasse de thé : le consentement c’est pas compliqué

Apparemment, beaucoup de mecs, mais VRAIMENT BEAUCOUP, ne captent pas ce que “consentement” veut dire. En effet, il semble que les gars ont un vrai problème à comprendre qu’avant de coucher avec quelqu’un, et ce à chaque fois que ça se pose, il faut s’assurer que cette personne a également envie de coucher avec vous. Pourtant c’est vraiment pas très difficile comme concept. Vraiment.
Si t’es encore en train de galérer à essayer de comprendre, imagine qu’au lieu de proposer du sexe, tu proposes une tasse de thé. Lire la suite par ici.